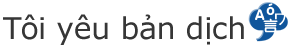- Văn bản
- Lịch sử
6. Les danseuses javanaises« Elles
6. Les danseuses javanaises
« Elles n'ont pas en ce moment de rivales à l'Exposition Universelle. Aucun spectacle n'est plus inattendu, ni plus curieux, et nos yeux d'Occidentaux blasés sont hypnotisés par ce troublant kaléidoscope qui grise et fascine comme le parfum empoisonné d'une fleur de mancenillier...
« Le corps de ballet se compose de cinq femmes et d'un homme, personnage effacé qui danse seulement avec la bonggens (sic); cette bayadere populaire, tant soit peu courtisane, va modestement de village en village, là où on l'appelle et où on la paie.
« Tout autres sont les quatre Tandak, Sarrkiem, Thamina, Soukia et Oua- kiham, dont la plus jeune a douze ans et l'aînée seize. Elles sont la propriété de Manka Negara, prince indépendant qui les a choisies parmi son corps de ballet composé de soixante sujets et qui ne les a prêtées que grâce à l'active intervention de M. Cores de Vries, délégué du Comité néerlandais, dont le père a rendu les plus importants services à la colonie. Les Tandak sont nées dans la forteresse du sultan d'où elles ne sont jamais sorties et qu'elles ne quitteront que pour épouser à l'époque indiquée par les rites, un homme de leur pays de Djogjakarta, la patrie sacrée des danseuses. A Java, la profession de ballerine n'implique nullement la vie joyeuse et les moeurs passablement folichonnes des jeunes personnes vouées, en Europe, au culte de Terpsichore...
« Les danseuses javanaises sont vêtues de somptueux costumes reproduisant presque identiquement certains bas-reliefs trouvés dans les ruines khmers, bas-reliefs qui doivent remonter au Ile siècle avant Jésus-Christ... D'un corselet de soie sans manches sortent des torses graciles, des épaules délicates, des corps souples, des formes d'une exquise et indécise mièvrerie... Les têtes sont casquées de tiares sacerdotales à la silhouette capricieuse, au cimier emplumé, aux fronteaux patiemment fouillés qui font penser à Salammbô - la vierge moitié reine et moitié prêtresse - et aux affolantes hallucinations de Gustave Moreau...
« Elles glissent dans une marche de rêve, les pieds presque immobiles, imposant aux torses des ondulations de reptile, agitant mollement les bras, donnant une intensité extraordinaire d'expression aux mains, tantôt menaçantes et tantôt caressantes, agressives ou enlaçantes, haineuses ou tendres, passionnées et parlantes. Elles tournent doucement leurs yeux d'émail fixés dans le vide; d'un geste languide, enfantin ou lascif, elles écartent leurs ceintures, puis s'en couvrent chastement les épaules.... Il y a une navrance si résignée au fond de ces danses bercées par le rythme pleurard du kamelong que, peu à peu, l'on se sent gagné par une tristesse ambiante indéfinissable... » (Frantz Jourdain).
Ce « kamelong » est celui qui inspira Debussy (cf. Archipel 25, pp.25-29).
Nous ne nous attarderons pas ici sur les confusions de F. Jourdain (le Mangku Negara « prince indépendant de Yogya », les bas-reliefs khmers du Ile s. avant J. C, etc.). Précisons seulement que W.F.A. Cores de Vries, le père du jeune délégué du Comité néerlandais, avait en effet aménagé au début des années 1860 le nouveau port de Surabaya.
« Elles n'ont pas en ce moment de rivales à l'Exposition Universelle. Aucun spectacle n'est plus inattendu, ni plus curieux, et nos yeux d'Occidentaux blasés sont hypnotisés par ce troublant kaléidoscope qui grise et fascine comme le parfum empoisonné d'une fleur de mancenillier...
« Le corps de ballet se compose de cinq femmes et d'un homme, personnage effacé qui danse seulement avec la bonggens (sic); cette bayadere populaire, tant soit peu courtisane, va modestement de village en village, là où on l'appelle et où on la paie.
« Tout autres sont les quatre Tandak, Sarrkiem, Thamina, Soukia et Oua- kiham, dont la plus jeune a douze ans et l'aînée seize. Elles sont la propriété de Manka Negara, prince indépendant qui les a choisies parmi son corps de ballet composé de soixante sujets et qui ne les a prêtées que grâce à l'active intervention de M. Cores de Vries, délégué du Comité néerlandais, dont le père a rendu les plus importants services à la colonie. Les Tandak sont nées dans la forteresse du sultan d'où elles ne sont jamais sorties et qu'elles ne quitteront que pour épouser à l'époque indiquée par les rites, un homme de leur pays de Djogjakarta, la patrie sacrée des danseuses. A Java, la profession de ballerine n'implique nullement la vie joyeuse et les moeurs passablement folichonnes des jeunes personnes vouées, en Europe, au culte de Terpsichore...
« Les danseuses javanaises sont vêtues de somptueux costumes reproduisant presque identiquement certains bas-reliefs trouvés dans les ruines khmers, bas-reliefs qui doivent remonter au Ile siècle avant Jésus-Christ... D'un corselet de soie sans manches sortent des torses graciles, des épaules délicates, des corps souples, des formes d'une exquise et indécise mièvrerie... Les têtes sont casquées de tiares sacerdotales à la silhouette capricieuse, au cimier emplumé, aux fronteaux patiemment fouillés qui font penser à Salammbô - la vierge moitié reine et moitié prêtresse - et aux affolantes hallucinations de Gustave Moreau...
« Elles glissent dans une marche de rêve, les pieds presque immobiles, imposant aux torses des ondulations de reptile, agitant mollement les bras, donnant une intensité extraordinaire d'expression aux mains, tantôt menaçantes et tantôt caressantes, agressives ou enlaçantes, haineuses ou tendres, passionnées et parlantes. Elles tournent doucement leurs yeux d'émail fixés dans le vide; d'un geste languide, enfantin ou lascif, elles écartent leurs ceintures, puis s'en couvrent chastement les épaules.... Il y a une navrance si résignée au fond de ces danses bercées par le rythme pleurard du kamelong que, peu à peu, l'on se sent gagné par une tristesse ambiante indéfinissable... » (Frantz Jourdain).
Ce « kamelong » est celui qui inspira Debussy (cf. Archipel 25, pp.25-29).
Nous ne nous attarderons pas ici sur les confusions de F. Jourdain (le Mangku Negara « prince indépendant de Yogya », les bas-reliefs khmers du Ile s. avant J. C, etc.). Précisons seulement que W.F.A. Cores de Vries, le père du jeune délégué du Comité néerlandais, avait en effet aménagé au début des années 1860 le nouveau port de Surabaya.
0/5000
6. Les danseuses javanaises« Elles n'ont pas en ce moment de rivales à l'Exposition Universelle. Aucun spectacle n'est plus inattendu, ni plus curieux, et nos yeux d'Occidentaux blasés sont hypnotisés par ce troublant kaléidoscope qui grise et fascine comme le parfum empoisonné d'une fleur de mancenillier...« Le corps de ballet se compose de cinq femmes et d'un homme, personnage effacé qui danse seulement avec la bonggens (sic); cette bayadere populaire, tant soit peu courtisane, va modestement de village en village, là où on l'appelle et où on la paie.« Tout autres sont les quatre Tandak, Sarrkiem, Thamina, Soukia et Oua- kiham, dont la plus jeune a douze ans et l'aînée seize. Elles sont la propriété de Manka Negara, prince indépendant qui les a choisies parmi son corps de ballet composé de soixante sujets et qui ne les a prêtées que grâce à l'active intervention de M. Cores de Vries, délégué du Comité néerlandais, dont le père a rendu les plus importants services à la colonie. Les Tandak sont nées dans la forteresse du sultan d'où elles ne sont jamais sorties et qu'elles ne quitteront que pour épouser à l'époque indiquée par les rites, un homme de leur pays de Djogjakarta, la patrie sacrée des danseuses. A Java, la profession de ballerine n'implique nullement la vie joyeuse et les moeurs passablement folichonnes des jeunes personnes vouées, en Europe, au culte de Terpsichore...« Les danseuses javanaises sont vêtues de somptueux costumes reproduisant presque identiquement certains bas-reliefs trouvés dans les ruines khmers, bas-reliefs qui doivent remonter au Ile siècle avant Jésus-Christ... D'un corselet de soie sans manches sortent des torses graciles, des épaules délicates, des corps souples, des formes d'une exquise et indécise mièvrerie... Les têtes sont casquées de tiares sacerdotales à la silhouette capricieuse, au cimier emplumé, aux fronteaux patiemment fouillés qui font penser à Salammbô - la vierge moitié reine et moitié prêtresse - et aux affolantes hallucinations de Gustave Moreau...« Elles glissent dans une marche de rêve, les pieds presque immobiles, imposant aux torses des ondulations de reptile, agitant mollement les bras, donnant une intensité extraordinaire d'expression aux mains, tantôt menaçantes et tantôt caressantes, agressives ou enlaçantes, haineuses ou tendres, passionnées et parlantes. Elles tournent doucement leurs yeux d'émail fixés dans le vide; d'un geste languide, enfantin ou lascif, elles écartent leurs ceintures, puis s'en couvrent chastement les épaules.... Il y a une navrance si résignée au fond de ces danses bercées par le rythme pleurard du kamelong que, peu à peu, l'on se sent gagné par une tristesse ambiante indéfinissable... » (Frantz Jourdain).Ce « kamelong » est celui qui inspira Debussy (cf. Archipel 25, pp.25-29).
Nous ne nous attarderons pas ici sur les confusions de F. Jourdain (le Mangku Negara « prince indépendant de Yogya », les bas-reliefs khmers du Ile s. avant J. C, etc.). Précisons seulement que W.F.A. Cores de Vries, le père du jeune délégué du Comité néerlandais, avait en effet aménagé au début des années 1860 le nouveau port de Surabaya.
Nous ne nous attarderons pas ici sur les confusions de F. Jourdain (le Mangku Negara « prince indépendant de Yogya », les bas-reliefs khmers du Ile s. avant J. C, etc.). Précisons seulement que W.F.A. Cores de Vries, le père du jeune délégué du Comité néerlandais, avait en effet aménagé au début des années 1860 le nouveau port de Surabaya.
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- In this organization, the cache connects
- Sừng
- make shop
- Immunity for industrial environments
- trong trường hợp vứt sai chỗ
- девушки
- ngươi lúc nãy không cho ta vào tổ
- tôi đã đọc cuốn sách rất nhiều lần và tô
- tax on
- safari cannot the page because it could
- Đỏ
- chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu
- дневник
- Man proposes God deproses
- ノルウェーの森
- trong trường hợp vứt rác sai chỗ
- where you get to know this job?who intro
- make Shopping
- Black
- sinh viên có muốn chia sẻ thông tin tài
- 0. FoolYou have grown up enough to strik
- Thus, according to the scores of importa
- тайный
- The hills