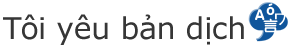- Văn bản
- Lịch sử
Que ce soit en France ou dans n’imp
Que ce soit en France ou dans n’importe quel autre pays, la langue évolue et le processus de création des variations langagières n’est pas un processus mécanique, mais un processus social et culturel. Le français contemporain est le résultat d’une évolution divergente. D’une part, l’orthographe, la syntaxe fondamentales et la morphologie n’ont guère changé depuis deux siècles, probablement parce que les usagers n’en ont pas ressenti le besoin. D’autre part, la phonétique et le lexique on subi de profondes transformations, alors que les différences phonologiques ont encore tendance à se réduire depuis le début du siècle, le vocabulaire est devenu de plus en plus complexe. Ceci est mon objectif tout au long de ce mémoire qui porte sur l’analyse des emprunts de français aux langues européennes.
En me basant sur tout ce dont mon mémoire s’agit, je souhaite qu’il contribue activement à relever l’évolution et le rôle des emprunts. À la fois témoin de la rencontre des savoirs, d’un échange entre diverses cultures et de la domination de l’une d’entre elles à un moment donné (et souvent, dans un domaine particulier), l’emprunt est la preuve que la langue est bien plus qu’un système figé. Il atteste de l’adaptation et de la perméabilité d’une langue donnée aux multiples évolutions qui l’entourent, qui la façonnent. Ce procédé de novation lexicale consiste notamment à adopterun terme nouveau en le « copiant » plus ou moins conformément à sa forme et son sens dans sa langue d’origine.
Mon mémoire qui avait pour objectif de comprendre le phénomène d’emprunt de français aux langues européennes, a permis de rendre compte de l’évolution de français. Cette dernière exprime l’intégration des emprunts (au système de français), qui se fait sur le plans phonologique, syntaxique, morphologique et sémantique. Au vu de ce mémoire, il nous semble très important de tenir davantage compte de la place qu’occupent les emprunts aux langues européennes dans le cadre de l’innovation lexicale français.
Contrairement aux siècles passés, du moins dans les pays de langue maternelle française (France, Belgique, Suisse, Québec), le français n’est plus l’apanage des classes privilégiées ni même l’affaire uniquement de la France. Toutes les couches de la population s’expriment maintenant dans une même langue et avec le minimum d’aisance nécessaire, tout en maintenant des différences locales. Il est possible que ce phénomène s’accentue en même temps que se maintiendront et se développeront différentes variétés de français à l’extérieur de la France. Lorsque l’unité linguistique est atteinte, il n’est plus nécessaire de poursuivre une uniformisation minutieuse. Mais aujourd’hui, maintenant que le français comme langue maternelle n’a jamais été aussi vivant, il doit relever le défi de hausser son statut comme langue seconde sur le plan international et faire face à la concurrence étrangère, principalement l’anglais
En me basant sur tout ce dont mon mémoire s’agit, je souhaite qu’il contribue activement à relever l’évolution et le rôle des emprunts. À la fois témoin de la rencontre des savoirs, d’un échange entre diverses cultures et de la domination de l’une d’entre elles à un moment donné (et souvent, dans un domaine particulier), l’emprunt est la preuve que la langue est bien plus qu’un système figé. Il atteste de l’adaptation et de la perméabilité d’une langue donnée aux multiples évolutions qui l’entourent, qui la façonnent. Ce procédé de novation lexicale consiste notamment à adopterun terme nouveau en le « copiant » plus ou moins conformément à sa forme et son sens dans sa langue d’origine.
Mon mémoire qui avait pour objectif de comprendre le phénomène d’emprunt de français aux langues européennes, a permis de rendre compte de l’évolution de français. Cette dernière exprime l’intégration des emprunts (au système de français), qui se fait sur le plans phonologique, syntaxique, morphologique et sémantique. Au vu de ce mémoire, il nous semble très important de tenir davantage compte de la place qu’occupent les emprunts aux langues européennes dans le cadre de l’innovation lexicale français.
Contrairement aux siècles passés, du moins dans les pays de langue maternelle française (France, Belgique, Suisse, Québec), le français n’est plus l’apanage des classes privilégiées ni même l’affaire uniquement de la France. Toutes les couches de la population s’expriment maintenant dans une même langue et avec le minimum d’aisance nécessaire, tout en maintenant des différences locales. Il est possible que ce phénomène s’accentue en même temps que se maintiendront et se développeront différentes variétés de français à l’extérieur de la France. Lorsque l’unité linguistique est atteinte, il n’est plus nécessaire de poursuivre une uniformisation minutieuse. Mais aujourd’hui, maintenant que le français comme langue maternelle n’a jamais été aussi vivant, il doit relever le défi de hausser son statut comme langue seconde sur le plan international et faire face à la concurrence étrangère, principalement l’anglais
0/5000
Cho dù ở nước Pháp hoặc trong bất kỳ quốc gia nào khác, ngôn ngữ phát triển và quá trình sáng tạo của các biến thể ngôn ngữ không phải là một quá trình cơ khí, nhưng một quá trình xã hội và văn hóa. Đương đại pháp là kết quả của một sự tiến hóa khác nhau. Một mặt, chính tả, cơ bản cú pháp và hình thái học đã thay đổi rất ít kể từ khi hai thế kỷ, có lẽ vì người dùng đã không cảm thấy nhu cầu. Mặt khác, ngữ âm học và lexicon chúng tôi bị biến đổi sâu sắc, trong khi sự khác biệt về ngữ âm vẫn có xu hướng thu nhỏ từ đầu thế kỷ, các từ vựng đã trở thành ngày càng phức tạp. Đây là mục tiêu của tôi trong suốt bộ nhớ này đề với phân tích của vay Pháp ngôn ngữ châu Âu.
dựa trên tất cả mọi thứ mà bộ nhớ của tôi là, tôi muốn nó góp phần tích cực để nâng cao sự tiến triển và vai trò của người vay. Gấu làm chứng của cuộc gặp gỡ của kiến thức, một cuộc trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau và sự thống trị của một người tại một thời điểm (và thường xuyên, trong một khu vực cụ thể), các khoản vay là bằng chứng rằng ngôn ngữ là nhiều hơn so với một hệ thống cấp đông. Ông các attests để thích ứng và tính thấm của một ngôn ngữ nhất định để phát triển nhiều mà bao quanh nó, hình dạng mà. Quá trình này từ vựng novation là đặc biệt để adopterun thuật ngữ mới bằng cách "sao chép" hơn phù hợp với hình dạng của nó và ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ của họ của nguồn gốc.
bộ nhớ của tôi mà nhằm mục đích để hiểu hiện tượng vay từ Pháp ngôn ngữ châu Âu, có thể tài khoản cho sự tiến hóa của Pháp. Sau này thể hiện sự tích hợp của vay (từ hệ thống Pháp), mà là các kế hoạch về ngữ âm, cú pháp, hình thái học và ngữ nghĩa. Trong ánh sáng của này giới thiệu tóm tắt, nó có vẻ rất quan trọng để có các tài khoản lớn hơn của nơi bị chiếm đóng bởi vay các ngôn ngữ châu Âu trong bối cảnh của sự đổi mới từ vựng tiếng Pháp.
không giống như nhiều thế kỷ qua, tối thiểu trong các quốc gia pháp tiếng mẹ đẻ (Pháp, Bỉ, Thụy sĩ, Quebec), các pháp không còn bảo tồn của các lớp học đặc quyền hoặc thậm chí chỉ vụ trên đất Pháp. Tất cả các phân đoạn của dân số bây giờ được thể hiện trong cùng một ngôn ngữ và với tối thiểu cần thiết một cách dễ dàng, trong khi sự khác biệt bây giờ địa phương. Có thể rằng hiện tượng này phát triển thậm chí thời gian sẽ tiếp tục và phát triển các giống khác nhau của Pháp bên ngoài của Pháp. Khi đạt đến sự thống nhất ngôn ngữ, nó là cần thiết để theo đuổi một tiêu chuẩn hóa cẩn thận. Nhưng hôm nay, bây giờ mà Pháp như tiếng mẹ đẻ chưa bao giờ như vậy còn sống, Ông phải đối mặt với những thách thức để tăng tình trạng của nó như là một ngôn ngữ thứ hai ngày quốc tế kế hoạch và phải đối mặt với cạnh tranh nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh
.
dựa trên tất cả mọi thứ mà bộ nhớ của tôi là, tôi muốn nó góp phần tích cực để nâng cao sự tiến triển và vai trò của người vay. Gấu làm chứng của cuộc gặp gỡ của kiến thức, một cuộc trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau và sự thống trị của một người tại một thời điểm (và thường xuyên, trong một khu vực cụ thể), các khoản vay là bằng chứng rằng ngôn ngữ là nhiều hơn so với một hệ thống cấp đông. Ông các attests để thích ứng và tính thấm của một ngôn ngữ nhất định để phát triển nhiều mà bao quanh nó, hình dạng mà. Quá trình này từ vựng novation là đặc biệt để adopterun thuật ngữ mới bằng cách "sao chép" hơn phù hợp với hình dạng của nó và ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ của họ của nguồn gốc.
bộ nhớ của tôi mà nhằm mục đích để hiểu hiện tượng vay từ Pháp ngôn ngữ châu Âu, có thể tài khoản cho sự tiến hóa của Pháp. Sau này thể hiện sự tích hợp của vay (từ hệ thống Pháp), mà là các kế hoạch về ngữ âm, cú pháp, hình thái học và ngữ nghĩa. Trong ánh sáng của này giới thiệu tóm tắt, nó có vẻ rất quan trọng để có các tài khoản lớn hơn của nơi bị chiếm đóng bởi vay các ngôn ngữ châu Âu trong bối cảnh của sự đổi mới từ vựng tiếng Pháp.
không giống như nhiều thế kỷ qua, tối thiểu trong các quốc gia pháp tiếng mẹ đẻ (Pháp, Bỉ, Thụy sĩ, Quebec), các pháp không còn bảo tồn của các lớp học đặc quyền hoặc thậm chí chỉ vụ trên đất Pháp. Tất cả các phân đoạn của dân số bây giờ được thể hiện trong cùng một ngôn ngữ và với tối thiểu cần thiết một cách dễ dàng, trong khi sự khác biệt bây giờ địa phương. Có thể rằng hiện tượng này phát triển thậm chí thời gian sẽ tiếp tục và phát triển các giống khác nhau của Pháp bên ngoài của Pháp. Khi đạt đến sự thống nhất ngôn ngữ, nó là cần thiết để theo đuổi một tiêu chuẩn hóa cẩn thận. Nhưng hôm nay, bây giờ mà Pháp như tiếng mẹ đẻ chưa bao giờ như vậy còn sống, Ông phải đối mặt với những thách thức để tăng tình trạng của nó như là một ngôn ngữ thứ hai ngày quốc tế kế hoạch và phải đối mặt với cạnh tranh nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh
.
đang được dịch, vui lòng đợi..


Que ce soit en France ou dans n’importe quel autre pays, la langue évolue et le processus de création des variations langagières n’est pas un processus mécanique, mais un processus social et culturel. Le français contemporain est le résultat d’une évolution divergente. D’une part, l’orthographe, la syntaxe fondamentales et la morphologie n’ont guère changé depuis deux siècles, probablement parce que les usagers n’en ont pas ressenti le besoin. D’autre part, la phonétique et le lexique on subi de profondes transformations, alors que les différences phonologiques ont encore tendance à se réduire depuis le début du siècle, le vocabulaire est devenu de plus en plus complexe. Ceci est mon objectif tout au long de ce mémoire qui porte sur l’analyse des emprunts de français aux langues européennes.
En me basant sur tout ce dont mon mémoire s’agit, je souhaite qu’il contribue activement à relever l’évolution et le rôle des emprunts. À la fois témoin de la rencontre des savoirs, d’un échange entre diverses cultures et de la domination de l’une d’entre elles à un moment donné (et souvent, dans un domaine particulier), l’emprunt est la preuve que la langue est bien plus qu’un système figé. Il atteste de l’adaptation et de la perméabilité d’une langue donnée aux multiples évolutions qui l’entourent, qui la façonnent. Ce procédé de novation lexicale consiste notamment à adopterun terme nouveau en le « copiant » plus ou moins conformément à sa forme et son sens dans sa langue d’origine.
Mon mémoire qui avait pour objectif de comprendre le phénomène d’emprunt de français aux langues européennes, a permis de rendre compte de l’évolution de français. Cette dernière exprime l’intégration des emprunts (au système de français), qui se fait sur le plans phonologique, syntaxique, morphologique et sémantique. Au vu de ce mémoire, il nous semble très important de tenir davantage compte de la place qu’occupent les emprunts aux langues européennes dans le cadre de l’innovation lexicale français.
Contrairement aux siècles passés, du moins dans les pays de langue maternelle française (France, Belgique, Suisse, Québec), le français n’est plus l’apanage des classes privilégiées ni même l’affaire uniquement de la France. Toutes les couches de la population s’expriment maintenant dans une même langue et avec le minimum d’aisance nécessaire, tout en maintenant des différences locales. Il est possible que ce phénomène s’accentue en même temps que se maintiendront et se développeront différentes variétés de français à l’extérieur de la France. Lorsque l’unité linguistique est atteinte, il n’est plus nécessaire de poursuivre une uniformisation minutieuse. Mais aujourd’hui, maintenant que le français comme langue maternelle n’a jamais été aussi vivant, il doit relever le défi de hausser son statut comme langue seconde sur le plan international et faire face à la concurrence étrangère, principalement l’anglais
En me basant sur tout ce dont mon mémoire s’agit, je souhaite qu’il contribue activement à relever l’évolution et le rôle des emprunts. À la fois témoin de la rencontre des savoirs, d’un échange entre diverses cultures et de la domination de l’une d’entre elles à un moment donné (et souvent, dans un domaine particulier), l’emprunt est la preuve que la langue est bien plus qu’un système figé. Il atteste de l’adaptation et de la perméabilité d’une langue donnée aux multiples évolutions qui l’entourent, qui la façonnent. Ce procédé de novation lexicale consiste notamment à adopterun terme nouveau en le « copiant » plus ou moins conformément à sa forme et son sens dans sa langue d’origine.
Mon mémoire qui avait pour objectif de comprendre le phénomène d’emprunt de français aux langues européennes, a permis de rendre compte de l’évolution de français. Cette dernière exprime l’intégration des emprunts (au système de français), qui se fait sur le plans phonologique, syntaxique, morphologique et sémantique. Au vu de ce mémoire, il nous semble très important de tenir davantage compte de la place qu’occupent les emprunts aux langues européennes dans le cadre de l’innovation lexicale français.
Contrairement aux siècles passés, du moins dans les pays de langue maternelle française (France, Belgique, Suisse, Québec), le français n’est plus l’apanage des classes privilégiées ni même l’affaire uniquement de la France. Toutes les couches de la population s’expriment maintenant dans une même langue et avec le minimum d’aisance nécessaire, tout en maintenant des différences locales. Il est possible que ce phénomène s’accentue en même temps que se maintiendront et se développeront différentes variétés de français à l’extérieur de la France. Lorsque l’unité linguistique est atteinte, il n’est plus nécessaire de poursuivre une uniformisation minutieuse. Mais aujourd’hui, maintenant que le français comme langue maternelle n’a jamais été aussi vivant, il doit relever le défi de hausser son statut comme langue seconde sur le plan international et faire face à la concurrence étrangère, principalement l’anglais
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- Phòng thí nghiệm Menlo Park
- 寝るよ!パイパイ!おやすみなさい
- sortir
- nó có bao nhiêu thành viên
- Những phát minh nổi tiếng của Ediso
- are you willing to take the Oath of Alle
- This would make any girl go "squee!
- 寝るよ おやすみなさい
- a dab of black ink good chips are select
- chúng tôi ăn uống và nói về ước mơ
- Máy điện tín
- No body knows
- I am listening to this... Feeling so muc
- đó là buổi chia tay cuối năm
- No baby knows
- Phù thủy xứ Menlo Park
- a low fat cake
- câu lạc bộ tiếng anh nằm ở đâu
- bạn tham gia câu lạc bộ đó lâu chưa
- Ich will du in Schlaf umarmen
- Máy chiếu phim
- nó được thành lập khi nào
- ranger
- what was the place like