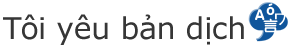- Văn bản
- Lịch sử
2Le point de départ de la recherche
2Le point de départ de la recherche de S.L. est la relation étroite unissant la langue officielle du roi et la parole de justice : « langue des rois et langue de justice sont deux notions qui se recouvrent étroitement durant tout le Moyen Âge » (p. 13). Une telle considération se justifie par l’appréhension originellement augustinienne du pouvoir royal et de sa mission. C’est pourquoi la représentation du roi comme dispensateur de la justice est fondamentale et imprègne la culture savante de tout le Moyen Âge. Mais, si le roi est la source de toute justice, l’exercice de celle-ci est déléguée, surtout à partir de la fin du XIIe siècle (redécouverte du droit savant romain) à des spécialistes qui seront soucieux de construire leur propre univers, soutenu par une langue savante et spécialisée, latine. Il était nécessaire, dans cette perspective, de rappeler les grands traits de l’histoire du droit en relation avec la langue (latin vs français juridique), ce que S.L. fait avec brio, dans une belle synthèse, concise et claire (p. 28-36). Après un petit survol du français juridique dans les autres pays de la Romania (p. 36-44), l’auteur entreprend de considérer ce qui est le noyau fondateur du travail, en termes de sources, à savoir les chartes de France, auxquelles est consacré tout le second chapitre du livre.
3
3
0/5000
2Le point de départ de la recherche de S.L. est la relation étroite unissant la langue officielle du roi et la parole de justice : « langue des rois et langue de justice sont deux notions qui se recouvrent étroitement durant tout le Moyen Âge » (p. 13). Une telle considération se justifie par l’appréhension originellement augustinienne du pouvoir royal et de sa mission. C’est pourquoi la représentation du roi comme dispensateur de la justice est fondamentale et imprègne la culture savante de tout le Moyen Âge. Mais, si le roi est la source de toute justice, l’exercice de celle-ci est déléguée, surtout à partir de la fin du XIIe siècle (redécouverte du droit savant romain) à des spécialistes qui seront soucieux de construire leur propre univers, soutenu par une langue savante et spécialisée, latine. Il était nécessaire, dans cette perspective, de rappeler les grands traits de l’histoire du droit en relation avec la langue (latin vs français juridique), ce que S.L. fait avec brio, dans une belle synthèse, concise et claire (p. 28-36). Après un petit survol du français juridique dans les autres pays de la Romania (p. 36-44), l’auteur entreprend de considérer ce qui est le noyau fondateur du travail, en termes de sources, à savoir les chartes de France, auxquelles est consacré tout le second chapitre du livre.3
đang được dịch, vui lòng đợi..


2The điểm bắt đầu của SL tìm kiếm là các mối quan hệ chặt chẽ thống nhất các ngôn ngữ chính thức của nhà vua và lời bình: "ngôn ngữ của các vị vua và ngôn ngữ công lý là hai khái niệm mà chồng lên nhau chặt chẽ trong thời Trung Cổ" (p 13. ). Một xem xét như vậy là hợp lý bởi Augustinô ban đầu sợ hãi của quyền lực hoàng gia và sứ mệnh của mình. Đây là lý do tại sao các đại diện của nhà vua là quả của công lý là nền tảng và nền văn hóa cao thấm vào toàn bộ Trung Cổ. Nhưng nếu nhà vua là nguồn gốc của tất cả công lý, việc thực hiện này được ủy quyền, đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ mười hai (tái khám phá của học giả luật La Mã) cho các chuyên gia, những người sẽ được quan tâm để xây dựng vũ trụ của riêng mình, được hỗ trợ bởi một ngôn ngữ chuyên ngành và học, Latin. Nó là cần thiết, trong bối cảnh này, để nhớ lại những tính năng chính của lịch sử của pháp luật liên quan đến ngôn ngữ (so với Latin Pháp pháp lý) SL mà không rực rỡ, trong một tổng hợp tuyệt đẹp, ngắn gọn và rõ ràng (p. 28 -36). Sau một tổng quan về các Pháp pháp lý ở các nước khác của Romania (p. 36-44), tác giả bắt đầu xem xét các lõi sáng lập của công việc là gì, về nguồn, cụ thể là các điều lệ của Pháp, mà dành toàn bộ chương thứ hai của cuốn sách. 3
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- tôi sưu tập bằng cách mua chúng ,anh hoặ
- You have tired
- tôi sưu tập bằng cách mua chúng ,anh hoặ
- My him
- cung đường
- How do you identify interests?The benefi
- 이 카드는 얼마 입니까?
- yield and lactation period
- schutz und pflege fur die Haut , fur jed
- How do you identify interests?The benefi
- Sao tôi hỏi bạn không trả lời? Chắc bạn
- can you tell me what's your name?
- write a general rule for the connection
- what is the basic idea of acupuncture
- chat
- Chung san lu
- Không hiểu sao nói chuyện với bạn tôi cả
- AT that time I Was trying read hard to m
- you want to take it. Let's take it
- kết quả bài thi của rất tệ thậm chí mình
- và còn các môn khác thì tôi chỉ học trun
- passenger
- Two parallel lines of research have show
- Cảm ơn bạn quá khenBạn sống ở đâu đến từ