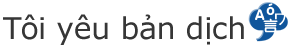- Văn bản
- Lịch sử
iRiSInstitut de Relations Internati
iRiS
Institut de Relations Internationales et Stratégiques
ASIE
PERSPECTIVES
STRATEGIQUES
CHINE 2014 : une diplomatie régionale pour le moins déroutante
n°12
janvier 2014
Sommaire
□ D’ici quelques jours, la République Populaire de Chine célébrera le traditionnel Nouvel an chinois (30 janv.), en cette année du Cheval de bois que l’on dit propice à l’inventivité, l’évolution, l’action et la réflexion. Derniè- rement, Pékin s’est déjà employée à diverses célébra- tions : en commémorant peu avant Noël le 120e anniver- saire de la naissance de Mao Zedong, le ‘’Grand Timo- nier’’, à grand renforts de défilés nostalgiques organisés à Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Une quarantaine d’an- nées après sa disparition (1976), étiré sur plusieurs dé- cennies, l’héritage de cet omnipotent dirigeant divise toujours (‘’Mao Zedong’s Legacy’’, BBC news, 23 déc. 2013) ses compatriotes et les sinologues. En dé- cembre toujours, dans un registre prêtant moins à polémique, la Chine et la France célébraient un
demi-siècle de relations diplomatiques, le Premier mi- nistre français J-M. Ayrault effectuant le déplacement vers la capitale chinoise pour marquer l’événement, dans l’impressionnant Grand Palais du Peuple, en pré- sence du Président Xi Jinping (6 déc. 2013). Huit mois après un déplacement similaire à Pékin du chef de l’Etat français F. Hollande (avril 2013), cette nouvelle visite protocolaire en République Populaire atteste de la bonne tenue actuelle de la relation franco-chinoise. Dans un passé récent (cf. en 2008, après le passage tu- multueux de la flamme olympique chinoise par Paris ; après également la brève rencontre entre le Président
N. Sarkozy et le leader spirituel tibétain, sa Sainteté le Dalai Lama), il n’en fut pas toujours ainsi. Un état de fait
contemporain dont il s’agit probablement de se féliciter.
□ En Asie-Pacifique, en ce début d’année 2014, il est di- verses capitales régionales à ne guère pouvoir se préva- loir d’une telle tonalité diplomatique avec l’ambitieuse et irascible Pékin. En janvier, Tokyo, Manille, New Delhi, Hanoi (manifestation anti-chinoise le 19 janv.), pour évo- quer quelques cas sensibles, ne se trouvent pas précisé- ment dans les petits papiers du gouvernement chinois ; la faute à un cortège de différents territoriaux éloignant Pékin de divers gouvernements voisins, à des plaies his- toriques douloureuses jamais cicatrisées (Chine—Japon), enfin, à une résurgence régionale du nationalisme pous- sant les responsables politiques à faire montre de (trop de ?) détermination dans la gestion de leurs divers con- tentieux interétatiques, mettant à mal la diploma-
tie et ses règles feutrées, au profit d’un langage
quasi-martial aux accents volontiers menaçants.
□ Puissance asiatique dominante du début du XXIe siècle, au cœur d’une kyrielle de disputes territoriales avec divers voisins, la Chine n’échappe pas à cette incli- naison. Pourtant, ne lit-on pas de sa plume au sujet de sa politique diplomatique : ‘’La Chine reste fidèle à sa politique diplomatique basée sur l'indépendance, l'auto- nomie et la paix, persévère dans une voie de développe- ment pacifique, poursuit une stratégie d'ouverture réci- proquement bénéfique, et œuvre à construire un monde harmonieux caractérisé par la paix durable et la prospé- rité commune’’ (site de l’ambassade de Chine en France) ? Une présentation des choses qui, au regard des différends régionaux impliquant Pékin évoqués ci- après, peinera a priori à emporter la conviction du lec- teur. l
Olivier Guillard, le 24 janvier 2014
Olivier Guillard est directeur de recherches Asie et enseignant à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),
également directeur de l’information chez Crisis 24, cabinet de conseil en gestion des risques et des crises.
2 bis rue Mercœur, 75 011 Paris—France ǁ tél. : 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
Quand le discours de Pékin emporte la conviction. Bien sûr, on ne saurait soutenir l’idée que la diplomatie chinoise en Asie - Pacifique se résume à une joute per- manente faisant fi des desiderata de ses voisins et n’accordant qu’une attention minimale au droit interna- tional ; une thèse qui relèverait de l’excès. La politique asiatique de Pékin ne prête pas uniquement à critique ; sur certains ’’dossiers’’ délicats, son concours se révèle précieux, son attitude à la fois contructive et équilibrée, ainsi qu’en attestent les quelques exemples ci-après :
CHINE - Péninsule coréenne. Une politique opi- niâtre et cohérente. La sensibilité du sujet (nucléarisation de la Corée du nord) et de ses principaux acteurs — à commencer par l’imprédictible et défiante Pyongyang - impose à la diplomatie chinoise un engage- ment permanent, une attention de tous les instants, a fortiori depuis la disparition du Cher Dirigeant Kim Jong- il (déc. 2011), la prise en mains du régime par son énig- matique fils Kim Jong-un, un nouvel aventurisme nu- cléaire (essai) en février 2012 et la purge brutale (exécution) du n°2 du régime et
oncle de Kim Jong-Un, Jang Song
Taek (déc. 2013), un interlocu- teur par ailleurs apprécié depuis des décennies des cercles du pouvoir pékinois. La volonté chi- noise de relancer le processus moribond (depuis 2008) des Pourparlers à six (les 2 Corée, Chine, Etats-Unis, Japon, Russie) sur le désarmement nucléaire nord-coréen, nonobstant les ré-
ticences et les doutes de Washington et de Séoul sur l’opportunité d’un tel projet, les frasques et les menaces de Pyongyang (promettant dernièrement à Séoul ‘’un holocauste inimaginable’’ en cas de manœuvres mili- taires contre la Corée du nord), mettent à rude épreuve ces trois dernières années l’appareil diplomatique chi- nois, dont il s’agit ici de louer les efforts et la patience. Bien sûr, il est sur ce sujet des observateurs à relever que la défiance dont fait montre bien trop souvent, par- fois jusqu’au seuil de l’irréparable, l’insaisissable régime nord-coréen, trouve son explication dans le soutien (diplomatique, énergétique, économique, voire alimen- taire) dispensé par le partenaire et voisin chinois.
CHINE - Birmanie. Evolution - adaptation - coopé- ration. S’il ne saurait reproduire à lui seul la trame de la diplomatie chinoise en Asie du sud-est — une région où le sentiment ‘’sino-sceptique’’ est notable et les diffé- rends interétatiques associant la Chine vivaces (voir p.3)
-, le contexte birman post-junte et l’engagement mesuré
d’ouverture et de réformes me- née tambours battant par le Président (tout ancien 1er mi- nistre de l’ancienne junte soit- il) Thein Sein extirpe avec suc- cès la Birmanie du ban des na- tions, réintroduit enfin le pays de La Dame de Rangoon dans le grand jeu international, au
point d’en faire dernièrement un des Etats les visités par les délégations diplomatiques et commerciales du monde entier. Il y a encore quatre ans, personne n’ima- ginait qu’un Président américain consacrerait son pre- mier déplacement à l’étranger après sa réélection à la Birmanie (ce que fit pourtant Barack Obama en nov. 2012). Pékin, en quasi tête-à-tête avec Naypyidaw lors du quart de siècle précédent (une fois que les Etats-Unis et l’Union européenne aient apposé divers strates de sanctions à la junte après les répressions anti- démocratie de 1988), s’accommode aujourd’hui - de plus ou moins bonne grâce certes— de ce contexte nou- veau où la Birmanie compte chaque jour de nouveaux partenaires. La période bénie (pour Pékin) de l’exclusivi- té et du huis clos est terminée ; s’ouvre celle d’une coo- pération intelligente au bénéfice mutuel (énergie ; con- flits ethniques ; commerce ; investissements ; ouverture sur le Golfe du Bengale, etc.).
Une adaptation imposée par la configuration politique de la Birmanie post-junte à laquelle Pékin semble s’ajus- ter ; une adaptation qui ne paraissait pourtant pas aller si aisément de soi.
CHINE — ASIE du sud. Un tour de force abouti. Nous reviendrons plus loin (voir pp.4-5), dans un re- gistre plus tendu, sur les contours bien distincts de la diplomatie chinoise à l’endroit du voisin (é)émergent indien. L’occasion ici de relever le succès impression- nant de la politique chinoise dans le sous-continent in- dien (sans l’Inde) ces dernières années et de mettre en exergue la prouesse suivante, objet de quelques ran- cœurs à Delhi : début 2014, alors que cette dernière partage des frontières (terrestres ou maritimes) avec ses six voisins du sous-continent (Pakistan, Bangladesh, Né- pal, Sri Lanka, Maldives et Bhoutan), Pékin peut globale- ment se prévaloir de relations diplomatiques bilatérales plus sereines — libres de tous différends substantiels — avec Islamabad,
Dacca, Katmandou, Colombo, Malé et Thimphu, que celles animant les rap- ports (souvent com-
(d’aucuns diraient habile) de Pékin méritent quelques
développements succincts. Depuis trois ans, la politique
plexes) du gouver-
nement indien et
Source : ARTE
des capitales mentionnées ci-dessus.
2 bis rue Mercœur, 75 011 Paris—France ǁ tél. : 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
Point n’est besoin ici d’insister sur la pérennité / solidité de l’étroite relation sino-pakistanaise, autrement plus stable et à l’abri des incessants sauts d’humeur que celle peinant à rassembler (contraints et forcés par la con- joncture régionale et une crise afghane sans fin) Was- hington et Islamabad, alliées pour le moins contre- nature.
Dans un registre là encore satisfaisant pour la diploma- tie chinoise, notons également, sur les marges du sous- continent indien, à mi-chemin vers l’Asie centrale, le positionnement réussi de Pékin dans la fébrile Kaboul ; entre l’assistance aux efforts de reconstruction et les s
0/5000
iRiS
Institut de quan hệ Internationales et stratégiques
Asia
quan điểm
chiến lược
Trung Quốc 2014: khu vực ngoại giao cho ít khó hiểu
n ° 12
ngày 2014
tóm tắt
□ trong ngày, Trung Quốc sẽ kỷ niệm truyền thống Trung Quốc năm mới (30 ngày), trong năm nay của ngựa gỗ được gọi là lợi cho sáng tạo, sự tiến hóa, hành động và sự phản ánh. Cuối - không nghi ngờ gì, Beijing đã được sử dụng trong nhiều tổ chức kỷ niệm - tions: kỷ niệm một thời gian ngắn trước khi Giáng sinh anniver TP-Sary của sự ra đời của Mao Trạch Đông, các "Grand Timo - từ chối", quân tiếp viện lớn của hoài cổ diễu hành được tổ chức ở Bắc Kinh, Shanghai hay Guangzhou. Một năm bốn mươi - sinh sau khi ông chết (1976), kéo dài trong một-một vài thập kỷ. những di sản của nhà lãnh đạo toàn năng này vẫn còn phân chia ("Mao Trạch Đông di sản", BBC news, ngày 23 tháng 12 năm 2013) đồng và nhà Hán học. De - tháng luôn luôn, trong một đăng ký trả tiền ít gây tranh cãi, Trung Quốc và nước Pháp tổ chức một
nửa thế kỷ của quan hệ ngoại giao, người đầu tiên Pháp bộ trưởng giữa J - M. Trung Quốc Ayrault làm cho du lịch đến thủ đô để đánh dấu sự kiện này, trong các cung điện Grand Ấn tượng của người dân, trong sự hiện diện của tổng thống Xi Jinping (6 tháng 12 năm 2013). Bảy tháng sau khi một động thái tương tự như người đứng đầu của các nhà nước Pháp F. Holland Beijing (tháng 4 năm 2013); Chuyến thăm giao thức mới này để Quốc attests đến việc tổ chức tốt hiện tại của mối quan hệ trung-Pháp. Trong quá khứ gần đây (x. trong năm 2008, sau đợt tu - multueux của ngọn đuốc Olympic Trung Quốc bởi Paris; sau cũng có cuộc họp ngắn giữa Tổng thống
N. Sarkozy và Tây Tạng lãnh đạo tinh thần, Thánh khiết của Ngài Đạt Lai Lạt Ma), nó đã không luôn luôn như vậy. Một nhà nước của
đương đại rằng nó có thể được hoan nghênh.
□ trong Asia-Pacific, đầu năm 2014, nó là di - khu vực gần như không thể đến thủ đô trả tiền là preva-loir đến giai điệu ngoại giao với Bắc Kinh đầy tham vọng và vị. Vào tháng Giêng, Tokyo, Manila, New Delhi, Hanoi (19 Jan chống người Trung Quốc cuộc biểu tình.), cho evo-quer một vài trường hợp nhạy cảm, là không chính xác - ment trong các giấy tờ nhỏ của chính phủ Trung Quốc. lỗi của một đám rước của chính phủ lân cận khác nhau lãnh thổ xa của Bắc Kinh, vết thương của mình - toric đau đớn không bao giờ chữa lành (Trung Quốc-Nhật bản), cuối cùng, một khu vực trỗi dậy của chủ nghĩa quốc gia pous-sant chính trị gia để chứng minh của (quá từ?) xác định trong việc quản lý của các con-inter-nhà nước táo bạo, với cái ác bằng tốt nghiệp-
tie và các quy tắc nỉ, ủng hộ một ngôn ngữ
quasi-võ dấu sẵn sàng. đe dọa
□ Châu á quyền lực thống trị từ đầu của thế kỷ 21, ở trung tâm của kinh cầu các tranh chấp lãnh thổ với các hàng xóm, Trung Quốc không thoát khỏi sự kết hợp độ nghiêng này. Tuy nhiên, chúng tôi có giường không bút của mình về chính sách ngoại giao của mình: "Trung Quốc vẫn trung thành với chính sách ngoại giao của mình dựa trên độc lập, tự-nền kinh tế và hòa bình, kiên trì theo phong cách của phát triển - ment hòa bình, theo đuổi một chiến lược mang lại lợi ích của mở reci-proquement, và làm việc để xây dựng một thế giới hài hòa đặc trưng bởi hòa bình lâu dài và thành công nghi thức phổ biến "(trang web của Đại sứ quán Trung Quốc ở nước Pháp)? Giới thiệu các điều đó, đối với khu vực tranh chấp liên quan đến Beijing đã đề cập ở trên - sau đó, sẽ đấu tranh một tiên nghiệm để lấy đi niềm tin của lec-Tor. l
Olivier Guillard,. 24 tháng 1 năm 2014
Olivier Guillard là nghiên cứu Châu á giám đốc và giáo viên tại Institut de quan hệ Internationales et stratégiques (IRIS),
cũng là giám đốc của thông tin trong tư vấn về khủng hoảng 24, rủi ro và quản lý khủng hoảng
2 bis rue Mercoeur, 75 011 Paris-France ǁ tel.: 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
.Khi bài phát biểu của Beijing mang niềm tin. Tất nhiên, nó không thể hỗ trợ ý tưởng rằng các ngoại giao Trung Quốc ở Châu á - Thái Bình Dương nắm đến một Joust một manente bỏ qua mong muốn của hàng xóm của nó và không cấp cho rằng sự chú ý tối thiểu để interna đúng - tế; một luận án sẽ là quá nhiều. Beijing Châu á chính sách không chỉ cho vay để chỉ trích; trên một số tinh tế 'tệp', cạnh tranh của nó chứng minh có giá trị, Thái độ của mình cả hai contructive và cân bằng, vì vậy mà chứng minh một vài ví dụ dưới đây:
Trung Quốc - bán đảo Triều tiên. Một chính sách opi-re và mạch lạc. Sự nhạy cảm của đối tượng (nuclearization của Bắc Triều tiên) và cầu thủ chính-bắt đầu với Pyongyang không thể đoán trước và thách thức - ngoại giao Trung Quốc một yêu cầu tham gia - ment vĩnh viễn sự chú ý tại mọi thời điểm, một fortiori kể từ sự biến mất của các nhà lãnh đạo thân yêu Kim Jong - nó (tháng mười hai 2011), tham gia trong tay của chế độ của nó enig - Matic sơn Kim Jong-un, một mới adventurism nu-cleaire (thử nghiệm) trong tháng hai 2012 và cuộc thanh trừng tàn bạo (thực hiện) của n ° 2 chế độ và
chú Kim Jong-Liên Hiệp Quốc, bài hát Jang
Taek (tháng 12 năm 2013), một interlocutory-cũng có thể thưởng thức các thập kỷ của vòng tròn Pekingese quyền lực. Sẽ chí - tiếng ồn để relaunch trình xã (từ 2008) của cuộc hội đàm với sáu (hai Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật bản, Liên bang Nga) trên giải trừ hạt nhân Bắc Triều tiên, Tuy nhiên re-
ticences và nghi ngờ từ Washington và Seoul vào mong muốn của dự án một, pranks và mối đe dọa của Bình Nhưỡng (đầy hứa hẹn mới tại Seoul "một Holocaust tưởng tượng" trong trường hợp của voisko mili-chủ sở hữu với Bắc Triều tiên) là căng thẳng này kéo dài ba năm chí ngoại giao đơn vị-nois, đây là thuê những nỗ lực và kiên nhẫn. Tất nhiên, nó là về điều này chủ đề của nhà quan sát lưu ý rằng tin tưởng mà minh họa tất cả các quá thường xuyên bởi - thời gian cho đến khi ngưỡng irreparable, chế độ Bắc Triều tiên khó nắm bắt, tìm thấy lời giải thích trong (hỗ trợ ngoại giao, năng lượng, kinh tế, và thậm chí cả thực phẩm - im lặng) giảng dạy bởi các đối tác và người hàng xóm Trung Quốc
Trung Quốc - Miến điện. Sự tiến hóa - thích ứng - coope - appropriation. Nếu nó không thể tái sản xuất để anh ta chỉ là vải của các ngoại giao Trung Quốc về phía đông nam á - một khu vực nơi mà cảm giác "chiến tranh Trung-sceptique" là đáng chú ý và khác nhau - giữa hai nhà nước tranh chấp liên quan đến Trung Quốc lâu năm (xem tr.3)
-. bối cảnh bài-junte Miến điện và đo tham gia
mở và cải cách tôi - sinh trống đánh bại do Tổng thống (cựu 1st giữa các bộ trưởng hội đồng tư vấn cũ hoặc - CNTT) Thein Sein kéo ra với suc - ces Miến điện từ ban na - tions, cuối cùng reintroduces đất nước của Lady Rangoon trong các trò chơi quốc tế lớn, để các
điểm đến gần đây là một trong các tiểu bang viếng thăm của các đại biểu của ngoại giao và thương mại trên toàn thế giới. Bốn năm trước đây, người không ima ginait rằng một tổng thống Hoa Kỳ sẽ cống hiến của mình trước-mier chuyến đi ra nước ngoài sau khi ông tái cử đến Miến điện (đó phù hợp nhưng Barack Obama vào tháng mười một năm 2012). Bắc Kinh, gần như mặt đối mặt với Naypyidaw trong thế kỷ quý trước (một lần), điều chỉnh ngày hôm nay - với hơn tốt ân sủng của khóa học - bối cảnh này mới nơi Miến điện tính đối tác mới mỗi ngày. Exclusivi-te may mắn (cho Bắc Kinh) và máy ảnh đóng cửa; sẽ mở ra với một coo thông minh hợp tác để cùng có lợi (năng lượng con-flicts dân tộc thương mại đầu tư; mở cửa vào vịnh Bengal, vv.).
Thích ứng áp đặt bởi các thiết lập chính trị Miến điện bài-junte mà Beijing dường như Adj - ter; một sự thích nghi đã không được xuất hiện để đi dễ dàng như vậy tự.
Trung Quốc - Nam á. Một tour du lịch thành công lực lượng. Chúng tôi sẽ trở lại sau này (xem pp.4 - 5), trong một đăng ký tightest tái trên những đường nét riêng biệt của các ngoại giao Trung Quốc hướng tới những người hàng xóm (e) đang nổi lên Ấn Độ. Cơ hội ở đây và nâng cao thành công in-nant của các chính sách Trung Quốc trong tiểu lục địa trong - điện (không có Ấn Độ) trong những năm qua để làm nổi bật đối tượng cùng, tiếp theo một số chạy-cơ ở Delhi: đầu năm 2014, do đó, rằng điều này kéo dài chia sẻ (đất hoặc biển) biên giới với nước láng giềng sáu trong tiểu lục địa (Pakistan, Bangladesh, sinh-pal, Sri Lanka, Maldives và Bhutan), Beijing có thể nói chung - ing dựa trên quan hệ ngoại giao song phương thanh thản hơn - miễn phí của tất cả các sự khác biệt đáng kể - với Islamabad,
Dhaka, Kathmandu, Colombo, Nam và Thimphu, hơn animating rap-cổng (thường com-
(d'aucuns diraient habile) của Bắc Kinh xứng đáng một số
gọn gàng phát triển.) Trong ba năm, chính sách
.phức tạp) của chính phủ-
Ấn Độ sự kiện và
nguồn: ARTE
vốn đã đề cập ở trên.
2 bis rue Mercoeur, 75 011 Paris-France ǁ tel.: 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
là cần thiết ở đây để nhấn mạnh tính bền vững / sức mạnh của mối quan hệ Trung-pakistanaise, hơn nữa nếu không ổn định và ra khỏi liên tục nhảy của tâm trạng hơn đấu tranh để thu thập (bắt buộc và bắt buộc bởi con-joncture khu vực và Afghanistan khủng hoảng không có kết thúc) đã là - hington và Islamabad, liên minh với các ít hơn chống lại-thiên nhiên.
trong một đăng ký có nhưng thỏa mãn cho bằng tốt nghiệp - tie Trung Quốc, ngoài ra, lưu ý trên rìa của tiểu lục địa, Ấn Độ lúc nửa đường tới Trung á, định vị các Bắc Kinh thành công vào sốt Kabul; giữa hỗ trợ cho những nỗ lực tái thiết và s
đang được dịch, vui lòng đợi..


iRiS
Institut de Relations Internationales et Stratégiques
ASIE
PERSPECTIVES
STRATEGIQUES
CHINE 2014 : une diplomatie régionale pour le moins déroutante
n°12
janvier 2014
Sommaire
□ D’ici quelques jours, la République Populaire de Chine célébrera le traditionnel Nouvel an chinois (30 janv.), en cette année du Cheval de bois que l’on dit propice à l’inventivité, l’évolution, l’action et la réflexion. Derniè- rement, Pékin s’est déjà employée à diverses célébra- tions : en commémorant peu avant Noël le 120e anniver- saire de la naissance de Mao Zedong, le ‘’Grand Timo- nier’’, à grand renforts de défilés nostalgiques organisés à Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Une quarantaine d’an- nées après sa disparition (1976), étiré sur plusieurs dé- cennies, l’héritage de cet omnipotent dirigeant divise toujours (‘’Mao Zedong’s Legacy’’, BBC news, 23 déc. 2013) ses compatriotes et les sinologues. En dé- cembre toujours, dans un registre prêtant moins à polémique, la Chine et la France célébraient un
demi-siècle de relations diplomatiques, le Premier mi- nistre français J-M. Ayrault effectuant le déplacement vers la capitale chinoise pour marquer l’événement, dans l’impressionnant Grand Palais du Peuple, en pré- sence du Président Xi Jinping (6 déc. 2013). Huit mois après un déplacement similaire à Pékin du chef de l’Etat français F. Hollande (avril 2013), cette nouvelle visite protocolaire en République Populaire atteste de la bonne tenue actuelle de la relation franco-chinoise. Dans un passé récent (cf. en 2008, après le passage tu- multueux de la flamme olympique chinoise par Paris ; après également la brève rencontre entre le Président
N. Sarkozy et le leader spirituel tibétain, sa Sainteté le Dalai Lama), il n’en fut pas toujours ainsi. Un état de fait
contemporain dont il s’agit probablement de se féliciter.
□ En Asie-Pacifique, en ce début d’année 2014, il est di- verses capitales régionales à ne guère pouvoir se préva- loir d’une telle tonalité diplomatique avec l’ambitieuse et irascible Pékin. En janvier, Tokyo, Manille, New Delhi, Hanoi (manifestation anti-chinoise le 19 janv.), pour évo- quer quelques cas sensibles, ne se trouvent pas précisé- ment dans les petits papiers du gouvernement chinois ; la faute à un cortège de différents territoriaux éloignant Pékin de divers gouvernements voisins, à des plaies his- toriques douloureuses jamais cicatrisées (Chine—Japon), enfin, à une résurgence régionale du nationalisme pous- sant les responsables politiques à faire montre de (trop de ?) détermination dans la gestion de leurs divers con- tentieux interétatiques, mettant à mal la diploma-
tie et ses règles feutrées, au profit d’un langage
quasi-martial aux accents volontiers menaçants.
□ Puissance asiatique dominante du début du XXIe siècle, au cœur d’une kyrielle de disputes territoriales avec divers voisins, la Chine n’échappe pas à cette incli- naison. Pourtant, ne lit-on pas de sa plume au sujet de sa politique diplomatique : ‘’La Chine reste fidèle à sa politique diplomatique basée sur l'indépendance, l'auto- nomie et la paix, persévère dans une voie de développe- ment pacifique, poursuit une stratégie d'ouverture réci- proquement bénéfique, et œuvre à construire un monde harmonieux caractérisé par la paix durable et la prospé- rité commune’’ (site de l’ambassade de Chine en France) ? Une présentation des choses qui, au regard des différends régionaux impliquant Pékin évoqués ci- après, peinera a priori à emporter la conviction du lec- teur. l
Olivier Guillard, le 24 janvier 2014
Olivier Guillard est directeur de recherches Asie et enseignant à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS),
également directeur de l’information chez Crisis 24, cabinet de conseil en gestion des risques et des crises.
2 bis rue Mercœur, 75 011 Paris—France ǁ tél. : 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
Quand le discours de Pékin emporte la conviction. Bien sûr, on ne saurait soutenir l’idée que la diplomatie chinoise en Asie - Pacifique se résume à une joute per- manente faisant fi des desiderata de ses voisins et n’accordant qu’une attention minimale au droit interna- tional ; une thèse qui relèverait de l’excès. La politique asiatique de Pékin ne prête pas uniquement à critique ; sur certains ’’dossiers’’ délicats, son concours se révèle précieux, son attitude à la fois contructive et équilibrée, ainsi qu’en attestent les quelques exemples ci-après :
CHINE - Péninsule coréenne. Une politique opi- niâtre et cohérente. La sensibilité du sujet (nucléarisation de la Corée du nord) et de ses principaux acteurs — à commencer par l’imprédictible et défiante Pyongyang - impose à la diplomatie chinoise un engage- ment permanent, une attention de tous les instants, a fortiori depuis la disparition du Cher Dirigeant Kim Jong- il (déc. 2011), la prise en mains du régime par son énig- matique fils Kim Jong-un, un nouvel aventurisme nu- cléaire (essai) en février 2012 et la purge brutale (exécution) du n°2 du régime et
oncle de Kim Jong-Un, Jang Song
Taek (déc. 2013), un interlocu- teur par ailleurs apprécié depuis des décennies des cercles du pouvoir pékinois. La volonté chi- noise de relancer le processus moribond (depuis 2008) des Pourparlers à six (les 2 Corée, Chine, Etats-Unis, Japon, Russie) sur le désarmement nucléaire nord-coréen, nonobstant les ré-
ticences et les doutes de Washington et de Séoul sur l’opportunité d’un tel projet, les frasques et les menaces de Pyongyang (promettant dernièrement à Séoul ‘’un holocauste inimaginable’’ en cas de manœuvres mili- taires contre la Corée du nord), mettent à rude épreuve ces trois dernières années l’appareil diplomatique chi- nois, dont il s’agit ici de louer les efforts et la patience. Bien sûr, il est sur ce sujet des observateurs à relever que la défiance dont fait montre bien trop souvent, par- fois jusqu’au seuil de l’irréparable, l’insaisissable régime nord-coréen, trouve son explication dans le soutien (diplomatique, énergétique, économique, voire alimen- taire) dispensé par le partenaire et voisin chinois.
CHINE - Birmanie. Evolution - adaptation - coopé- ration. S’il ne saurait reproduire à lui seul la trame de la diplomatie chinoise en Asie du sud-est — une région où le sentiment ‘’sino-sceptique’’ est notable et les diffé- rends interétatiques associant la Chine vivaces (voir p.3)
-, le contexte birman post-junte et l’engagement mesuré
d’ouverture et de réformes me- née tambours battant par le Président (tout ancien 1er mi- nistre de l’ancienne junte soit- il) Thein Sein extirpe avec suc- cès la Birmanie du ban des na- tions, réintroduit enfin le pays de La Dame de Rangoon dans le grand jeu international, au
point d’en faire dernièrement un des Etats les visités par les délégations diplomatiques et commerciales du monde entier. Il y a encore quatre ans, personne n’ima- ginait qu’un Président américain consacrerait son pre- mier déplacement à l’étranger après sa réélection à la Birmanie (ce que fit pourtant Barack Obama en nov. 2012). Pékin, en quasi tête-à-tête avec Naypyidaw lors du quart de siècle précédent (une fois que les Etats-Unis et l’Union européenne aient apposé divers strates de sanctions à la junte après les répressions anti- démocratie de 1988), s’accommode aujourd’hui - de plus ou moins bonne grâce certes— de ce contexte nou- veau où la Birmanie compte chaque jour de nouveaux partenaires. La période bénie (pour Pékin) de l’exclusivi- té et du huis clos est terminée ; s’ouvre celle d’une coo- pération intelligente au bénéfice mutuel (énergie ; con- flits ethniques ; commerce ; investissements ; ouverture sur le Golfe du Bengale, etc.).
Une adaptation imposée par la configuration politique de la Birmanie post-junte à laquelle Pékin semble s’ajus- ter ; une adaptation qui ne paraissait pourtant pas aller si aisément de soi.
CHINE — ASIE du sud. Un tour de force abouti. Nous reviendrons plus loin (voir pp.4-5), dans un re- gistre plus tendu, sur les contours bien distincts de la diplomatie chinoise à l’endroit du voisin (é)émergent indien. L’occasion ici de relever le succès impression- nant de la politique chinoise dans le sous-continent in- dien (sans l’Inde) ces dernières années et de mettre en exergue la prouesse suivante, objet de quelques ran- cœurs à Delhi : début 2014, alors que cette dernière partage des frontières (terrestres ou maritimes) avec ses six voisins du sous-continent (Pakistan, Bangladesh, Né- pal, Sri Lanka, Maldives et Bhoutan), Pékin peut globale- ment se prévaloir de relations diplomatiques bilatérales plus sereines — libres de tous différends substantiels — avec Islamabad,
Dacca, Katmandou, Colombo, Malé et Thimphu, que celles animant les rap- ports (souvent com-
(d’aucuns diraient habile) de Pékin méritent quelques
développements succincts. Depuis trois ans, la politique
plexes) du gouver-
nement indien et
Source : ARTE
des capitales mentionnées ci-dessus.
2 bis rue Mercœur, 75 011 Paris—France ǁ tél. : 01 53 27 60 60 ǁ guillard@iris-france.org
www.iris-france.org
Point n’est besoin ici d’insister sur la pérennité / solidité de l’étroite relation sino-pakistanaise, autrement plus stable et à l’abri des incessants sauts d’humeur que celle peinant à rassembler (contraints et forcés par la con- joncture régionale et une crise afghane sans fin) Was- hington et Islamabad, alliées pour le moins contre- nature.
Dans un registre là encore satisfaisant pour la diploma- tie chinoise, notons également, sur les marges du sous- continent indien, à mi-chemin vers l’Asie centrale, le positionnement réussi de Pékin dans la fébrile Kaboul ; entre l’assistance aux efforts de reconstruction et les s
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- the customer's specific complaint was no
- i assure you that the contract was revie
- - Besides, there are also resorts with f
- No numbers required after the dot
- in a contract, one specific word can cha
- what assurance is there that the company
- oui mais fais vite je suis desbordée auj
- essential word for the toeic
- vợ chồng tôi. sẽ có tiệc cho bạn
- 小情人 請你不要這麼早出現讓我可以多點時間享受這美麗的單身生活
- oui mais fais vite je suis débordée aujo
- word families
- Hãy sống và yêu, để mỗi ngày đi qua đều
- 小情人 請你不要這麼早出現讓我可以多點時間享受這美麗的單身的生活
- juste une quesition c'est pour ma soeur
- 小情人 請你不要這麼早出現讓我可以多點時間享受這美麗的單身的生活
- juste une question c'est pour ma soeur e
- bạn có hiểu không
- juste une question c'est pour ma soeur e
- if both parties agree to the terms, we c
- jourdan chauffe-eau solaires bonjour
- AH bon ils sont ici ?
- as soon as the labor agreement was signe
- salut sylvie c'est fiona tu as un moment