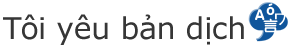- Văn bản
- Lịch sử
- Les mises en commun des démarches
- Les mises en commun des démarches et productions prennent-elles en compte les contributions de tous les élèves, y com¬pris des plus lents? Far ailleurs, quelles sont les activités prévues pour les élèves plus rapides?
- Quelle est la responsabilité des élèves dans la gestion de leurs activités?
- Dans quelle mesure le statut des activi-tés est-il différencié, entre les activités incontournables et facultatives? Les élèves lents peuvent-ils aussi bénéficier des activités dites «libres»?
- Quels sont les repères fournis aux élèves pour gérer le temps? Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les élèves plus lents à démarrer une activité, à organiser leur travail, à mener à terme la tâche?
- Dans quelle mesure l’enseignant par- vient-il à privilégier des temps de régula-tion interactive (Allai, 1979) plus particu-lièrement destinés à ces élèves?
- Quels modes de groupement des élèves organiser pour soutenir les activités des élèves plus lents?
- Quel suivi des différentes progressions mettre en place? Avec quelle implication de l’élève?
Il n’y a pas de dispositifs clés en main qu’il suffirait d’appliquer Chercher à considé¬rer les différents rythmes d’apprentissage demande un constant questionnement sur les situations d’apprentissage mises en place et les activités effectives des élèves Le but est d’optimaliser le temps de for-mation si possible pour tous les élèves, dans une perspective de régulation conti-nue des apprentissages (Perrenoud, 1997)
Dans une école traditionnellement organi-sée en degrés annuels, le rythme lent d’un élève était sanctionné par une mesure de redoublement. Il sera intéressant d’obser-ver si le fonctionnement de l’école primai¬re en cycles va effectivement permettre de considérer les différents rythmes d’ap-prentissage autrement que par une déci-sion de maintien d’une année supplémen-taire dans le cycle
Un problème de rythme, mais un problème pour qui?
A l’heure où tout concourt dans notre société à la rapidité et à l’efficacité, le rythme lent d’un élève est souvent perçu comme une caractéristique négative II est vrai que celle-ci est souvent associée à des difficultés scolaires (Huberman, 1984), avec des impacts non négligeables sur les carrières scolaires Mais la lenteur d’un élève est-elle forcément à ranger dans la catégorie des défauts?
«Comprendre, c’est lent», dit Albert Jacquard
«Quand on est pressé, il faut savoir perdre du temps», reprend le dicton populaire Développer des démarches qui ne soient
pas de simples reproductions nécessite parfois un cheminement long et labo¬rieux Le fait de devoir tâtonner, dévelop¬per une heuristique, remettre en question une procédure, reconsidérer le but de la tâche, concevoir une nouvelle démarche, chercher à contrôler la réalisation de son travail, consulter des ressources, etc , prend du temps. Cela permet surtout à l’élève d’entrer dans un rapport actif au savoir On peut se demander si une activi¬té rondement menée, sans tâtonnement aucun ni erreur, offre véritablement les conditions d’un nouvel apprentissage ou si elle ne fait que mettre en évidence les acquis des élèves
A mon sens, ce commentaire conduit à interroger les normes et les valeurs plus particulièrement privilégiées dans les classes En effet, dans quelle mesure les pratiques propres à chaque communauté classe attribuent-elles davantage de valeur, par exemple, aux productions per-sonnelles, aux démarches de recherche, à la réflexion, à la créativité, à la prise de conscience des apprentissages réalisés plutôt qu’à la rapidité d’exécution? Et, si tel est le cas, il importe encore de se pré-occuper de savoir si ces démarches péda-gogiques dites plus actives conviennent véritablement à tous les élèves (Perrenoud, 1995), y compris aux élèves plus lents
- Quelle est la responsabilité des élèves dans la gestion de leurs activités?
- Dans quelle mesure le statut des activi-tés est-il différencié, entre les activités incontournables et facultatives? Les élèves lents peuvent-ils aussi bénéficier des activités dites «libres»?
- Quels sont les repères fournis aux élèves pour gérer le temps? Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les élèves plus lents à démarrer une activité, à organiser leur travail, à mener à terme la tâche?
- Dans quelle mesure l’enseignant par- vient-il à privilégier des temps de régula-tion interactive (Allai, 1979) plus particu-lièrement destinés à ces élèves?
- Quels modes de groupement des élèves organiser pour soutenir les activités des élèves plus lents?
- Quel suivi des différentes progressions mettre en place? Avec quelle implication de l’élève?
Il n’y a pas de dispositifs clés en main qu’il suffirait d’appliquer Chercher à considé¬rer les différents rythmes d’apprentissage demande un constant questionnement sur les situations d’apprentissage mises en place et les activités effectives des élèves Le but est d’optimaliser le temps de for-mation si possible pour tous les élèves, dans une perspective de régulation conti-nue des apprentissages (Perrenoud, 1997)
Dans une école traditionnellement organi-sée en degrés annuels, le rythme lent d’un élève était sanctionné par une mesure de redoublement. Il sera intéressant d’obser-ver si le fonctionnement de l’école primai¬re en cycles va effectivement permettre de considérer les différents rythmes d’ap-prentissage autrement que par une déci-sion de maintien d’une année supplémen-taire dans le cycle
Un problème de rythme, mais un problème pour qui?
A l’heure où tout concourt dans notre société à la rapidité et à l’efficacité, le rythme lent d’un élève est souvent perçu comme une caractéristique négative II est vrai que celle-ci est souvent associée à des difficultés scolaires (Huberman, 1984), avec des impacts non négligeables sur les carrières scolaires Mais la lenteur d’un élève est-elle forcément à ranger dans la catégorie des défauts?
«Comprendre, c’est lent», dit Albert Jacquard
«Quand on est pressé, il faut savoir perdre du temps», reprend le dicton populaire Développer des démarches qui ne soient
pas de simples reproductions nécessite parfois un cheminement long et labo¬rieux Le fait de devoir tâtonner, dévelop¬per une heuristique, remettre en question une procédure, reconsidérer le but de la tâche, concevoir une nouvelle démarche, chercher à contrôler la réalisation de son travail, consulter des ressources, etc , prend du temps. Cela permet surtout à l’élève d’entrer dans un rapport actif au savoir On peut se demander si une activi¬té rondement menée, sans tâtonnement aucun ni erreur, offre véritablement les conditions d’un nouvel apprentissage ou si elle ne fait que mettre en évidence les acquis des élèves
A mon sens, ce commentaire conduit à interroger les normes et les valeurs plus particulièrement privilégiées dans les classes En effet, dans quelle mesure les pratiques propres à chaque communauté classe attribuent-elles davantage de valeur, par exemple, aux productions per-sonnelles, aux démarches de recherche, à la réflexion, à la créativité, à la prise de conscience des apprentissages réalisés plutôt qu’à la rapidité d’exécution? Et, si tel est le cas, il importe encore de se pré-occuper de savoir si ces démarches péda-gogiques dites plus actives conviennent véritablement à tous les élèves (Perrenoud, 1995), y compris aux élèves plus lents
0/5000
- Les mises en commun des démarches et productions prennent-elles en compte les contributions de tous les élèves, y com¬pris des plus lents? Far ailleurs, quelles sont les activités prévues pour les élèves plus rapides?- Quelle est la responsabilité des élèves dans la gestion de leurs activités?- Dans quelle mesure le statut des activi-tés est-il différencié, entre les activités incontournables et facultatives? Les élèves lents peuvent-ils aussi bénéficier des activités dites «libres»?- Quels sont les repères fournis aux élèves pour gérer le temps? Qu'est-ce qui est mis en place pour aider les élèves plus lents à démarrer une activité, à organiser leur travail, à mener à terme la tâche?- Dans quelle mesure l’enseignant par- vient-il à privilégier des temps de régula-tion interactive (Allai, 1979) plus particu-lièrement destinés à ces élèves?- Quels modes de groupement des élèves organiser pour soutenir les activités des élèves plus lents?- Quel suivi des différentes progressions mettre en place? Avec quelle implication de l’élève?Il n’y a pas de dispositifs clés en main qu’il suffirait d’appliquer Chercher à considé¬rer les différents rythmes d’apprentissage demande un constant questionnement sur les situations d’apprentissage mises en place et les activités effectives des élèves Le but est d’optimaliser le temps de for-mation si possible pour tous les élèves, dans une perspective de régulation conti-nue des apprentissages (Perrenoud, 1997)Dans une école traditionnellement organi-sée en degrés annuels, le rythme lent d’un élève était sanctionné par une mesure de redoublement. Il sera intéressant d’obser-ver si le fonctionnement de l’école primai¬re en cycles va effectivement permettre de considérer les différents rythmes d’ap-prentissage autrement que par une déci-sion de maintien d’une année supplémen-taire dans le cycleUn problème de rythme, mais un problème pour qui?A l’heure où tout concourt dans notre société à la rapidité et à l’efficacité, le rythme lent d’un élève est souvent perçu comme une caractéristique négative II est vrai que celle-ci est souvent associée à des difficultés scolaires (Huberman, 1984), avec des impacts non négligeables sur les carrières scolaires Mais la lenteur d’un élève est-elle forcément à ranger dans la catégorie des défauts?«Comprendre, c’est lent», dit Albert Jacquard«Quand on est pressé, il faut savoir perdre du temps», reprend le dicton populaire Développer des démarches qui ne soientpas de simples reproductions nécessite parfois un cheminement long et labo¬rieux Le fait de devoir tâtonner, dévelop¬per une heuristique, remettre en question une procédure, reconsidérer le but de la tâche, concevoir une nouvelle démarche, chercher à contrôler la réalisation de son travail, consulter des ressources, etc , prend du temps. Cela permet surtout à l’élève d’entrer dans un rapport actif au savoir On peut se demander si une activi¬té rondement menée, sans tâtonnement aucun ni erreur, offre véritablement les conditions d’un nouvel apprentissage ou si elle ne fait que mettre en évidence les acquis des élèvesA mon sens, ce commentaire conduit à interroger les normes et les valeurs plus particulièrement privilégiées dans les classes En effet, dans quelle mesure les pratiques propres à chaque communauté classe attribuent-elles davantage de valeur, par exemple, aux productions per-sonnelles, aux démarches de recherche, à la réflexion, à la créativité, à la prise de conscience des apprentissages réalisés plutôt qu’à la rapidité d’exécution? Et, si tel est le cas, il importe encore de se pré-occuper de savoir si ces démarches péda-gogiques dites plus actives conviennent véritablement à tous les élèves (Perrenoud, 1995), y compris aux élèves plus lents
đang được dịch, vui lòng đợi..


- Các phương pháp tiếp cận gộp chung và sản phẩm họ đưa vào tài khoản các khoản đóng góp của tất cả học sinh, com¬pris nó chậm hơn? Viễn Hơn nữa, các hoạt động dự kiến cho học sinh nhanh hơn là những gì?
- Trách nhiệm của sinh viên trong việc quản lý các hoạt động của họ là gì?
- Làm thế nào tình trạng của activi-quan hệ là nó phân biệt giữa các hoạt động cần thiết và bắt buộc? Người học chậm có thể họ cũng được hưởng lợi từ các hoạt động gọi là "tự do"?
- Các tiêu chuẩn cung cấp cho sinh viên để quản lý thời gian là gì? Là gì tại chỗ để giúp các học sinh chậm hơn để bắt đầu một doanh nghiệp, tổ chức công việc, có được công việc chạy?
- Làm thế nào giáo viên đi biệt ông ưa thích lần Interactive regula-tion (Allal, 1979) hơn particu biệt, đối với những học sinh?
- chế độ gì của nhóm sinh viên tổ chức để hỗ trợ các hoạt động của người học chậm?
- sau gì cung tiến khác nhau đưa ra? Làm thế nào tham gia của học sinh?
Không có thiết bị quan trọng trong tay nó sẽ đáp ứng để áp dụng Seek considé¬rer các mức độ khác nhau của học tập đòi hỏi chất vấn liên tục của các tình huống học tập thiết lập và hoạt động sinh viên thực tế Mục đích là để tối ưu hóa cho thời gian thông nếu có thể cho tất cả học sinh, với quan điểm quy định Conti-nue học tập (Perrenoud, 1997)
Trong một truyền thống chức kinh-thấy độ học hàng năm tốc độ chậm của một học sinh đã bị trừng phạt bởi một sự lặp lại phép đo. Nó sẽ được thú vị để OB-ver nếu các hoạt động của trường chu kỳ primai¬re sẽ thực sự cho phép xem xét các nhịp ap-độc chì khác nhau khác hơn là bởi một deci-sion duy trì một sự im lặng Addï năm chu kỳ
Một vấn đề nhịp điệu, nhưng một vấn đề cho rằng?
Vào thời điểm khi xã hội chúng ta đều góp phần vào tốc độ và hiệu quả, tốc độ chậm của một học sinh thường được coi như một đặc điểm tiêu cực Đúng là nó thường được kết hợp với những khó khăn học tập (Huberman, 1984), với tác động đáng kể vào sự nghiệp học tập Nhưng sự chậm chạp của một học sinh cô đang bị ràng buộc để rơi vào danh mục các sai sót?
"Để hiểu được chậm ", Albert
Jacquard" Khi bạn đang ở trong một vội vàng, bạn phải tốn thời gian ", tiếp tục phổ biến nói Phát triển phương pháp tiếp cận mà
không phải chỉ là những bản sao đôi khi đòi hỏi một quá trình lâu dài và labo¬rieux Có mò mẫm, devel heuristics ¬per, thủ tục thách thức, xem xét lại mục đích của công việc, để thiết kế một cách tiếp cận mới, tìm cách kiểm soát việc thực hiện các công việc của mình, hãy tham khảo tài nguyên, vv, cần có thời gian. Điều này cho phép đặc biệt là các sinh viên để vào một mối quan hệ tích cực với các kiến thức Một điều kỳ diệu nếu activi¬té tiến hành suôn sẻ mà không có bất cứ phỏng đoán hoặc lỗi, thực sự cung cấp các điều kiện cho việc học tập mới hoặc nếu nó chỉ puts Sinh viên nổi bật
quan điểm của tôi, nhận xét này dẫn đến câu hỏi về định mức và giá trị đặc biệt được ưa chuộng trong các lớp học thực tế, cách thực hành cụ thể cho mỗi cộng đồng lớp họ thuộc tính giá trị hơn, ví dụ, để mỗi điểm cá sản xuất, phương pháp nghiên cứu, suy nghĩ, sáng tạo, ý thức học tập đạt được chứ không phải là tính kịp thời? Và, nếu đó là trường hợp, nó vẫn rất quan trọng trước chiếm liệu những phương pháp tiếp cận peda-gogical nói thực sự phù hợp hơn cho tất cả học sinh tích cực (Perrenoud, 1995), bao gồm cả người học chậm
- Trách nhiệm của sinh viên trong việc quản lý các hoạt động của họ là gì?
- Làm thế nào tình trạng của activi-quan hệ là nó phân biệt giữa các hoạt động cần thiết và bắt buộc? Người học chậm có thể họ cũng được hưởng lợi từ các hoạt động gọi là "tự do"?
- Các tiêu chuẩn cung cấp cho sinh viên để quản lý thời gian là gì? Là gì tại chỗ để giúp các học sinh chậm hơn để bắt đầu một doanh nghiệp, tổ chức công việc, có được công việc chạy?
- Làm thế nào giáo viên đi biệt ông ưa thích lần Interactive regula-tion (Allal, 1979) hơn particu biệt, đối với những học sinh?
- chế độ gì của nhóm sinh viên tổ chức để hỗ trợ các hoạt động của người học chậm?
- sau gì cung tiến khác nhau đưa ra? Làm thế nào tham gia của học sinh?
Không có thiết bị quan trọng trong tay nó sẽ đáp ứng để áp dụng Seek considé¬rer các mức độ khác nhau của học tập đòi hỏi chất vấn liên tục của các tình huống học tập thiết lập và hoạt động sinh viên thực tế Mục đích là để tối ưu hóa cho thời gian thông nếu có thể cho tất cả học sinh, với quan điểm quy định Conti-nue học tập (Perrenoud, 1997)
Trong một truyền thống chức kinh-thấy độ học hàng năm tốc độ chậm của một học sinh đã bị trừng phạt bởi một sự lặp lại phép đo. Nó sẽ được thú vị để OB-ver nếu các hoạt động của trường chu kỳ primai¬re sẽ thực sự cho phép xem xét các nhịp ap-độc chì khác nhau khác hơn là bởi một deci-sion duy trì một sự im lặng Addï năm chu kỳ
Một vấn đề nhịp điệu, nhưng một vấn đề cho rằng?
Vào thời điểm khi xã hội chúng ta đều góp phần vào tốc độ và hiệu quả, tốc độ chậm của một học sinh thường được coi như một đặc điểm tiêu cực Đúng là nó thường được kết hợp với những khó khăn học tập (Huberman, 1984), với tác động đáng kể vào sự nghiệp học tập Nhưng sự chậm chạp của một học sinh cô đang bị ràng buộc để rơi vào danh mục các sai sót?
"Để hiểu được chậm ", Albert
Jacquard" Khi bạn đang ở trong một vội vàng, bạn phải tốn thời gian ", tiếp tục phổ biến nói Phát triển phương pháp tiếp cận mà
không phải chỉ là những bản sao đôi khi đòi hỏi một quá trình lâu dài và labo¬rieux Có mò mẫm, devel heuristics ¬per, thủ tục thách thức, xem xét lại mục đích của công việc, để thiết kế một cách tiếp cận mới, tìm cách kiểm soát việc thực hiện các công việc của mình, hãy tham khảo tài nguyên, vv, cần có thời gian. Điều này cho phép đặc biệt là các sinh viên để vào một mối quan hệ tích cực với các kiến thức Một điều kỳ diệu nếu activi¬té tiến hành suôn sẻ mà không có bất cứ phỏng đoán hoặc lỗi, thực sự cung cấp các điều kiện cho việc học tập mới hoặc nếu nó chỉ puts Sinh viên nổi bật
quan điểm của tôi, nhận xét này dẫn đến câu hỏi về định mức và giá trị đặc biệt được ưa chuộng trong các lớp học thực tế, cách thực hành cụ thể cho mỗi cộng đồng lớp họ thuộc tính giá trị hơn, ví dụ, để mỗi điểm cá sản xuất, phương pháp nghiên cứu, suy nghĩ, sáng tạo, ý thức học tập đạt được chứ không phải là tính kịp thời? Và, nếu đó là trường hợp, nó vẫn rất quan trọng trước chiếm liệu những phương pháp tiếp cận peda-gogical nói thực sự phù hợp hơn cho tất cả học sinh tích cực (Perrenoud, 1995), bao gồm cả người học chậm
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- honeymoon
- Packet Tracer - Exploring Internetworkin
- 5.3. Bên Thuê có quyền yêu cầu Bên Cho T
- Barnd rất thích âm nhạc phải không?
- những hệ thống tương đối dễ
- Packet Tracer - Exploring Internetworkin
- to eat out in Seoul
- BHA exhibits antioxidant properties and
- After one or two large factories.....bus
- You van chua lam bai tap ve nah
- 14.00pm . About 40 min from now
- Hello Hai! How are you? It's been a long
- Vấn đề
- Speak more fluently
- Điều kiện kinh tế ngày nay thì tốt hơn h
- honey moon
- 毫无保留?真是可笑之极。神圣世家的所作所为,想必其他世家都看在眼里,沈鸿家主辩驳
- những Công việc sẽ được hoàn thành theo
- d'enseignement efficace desmathématiques
- By the age of 30
- 甲方
- xe tốc hành
- conversation
- mua bán hàng hóa