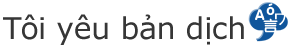- Văn bản
- Lịch sử
On appelle phrase complexe toute ph
On appelle phrase complexe toute phrase qui est composée de plusieurs propositions en ce sens qu'elle possède plus d'un verbe conjugué.
I Typologie des phrases complexes
Le premier membre de la phrase sera appelé protase et le second membre apodose.
Protase Apodose
juxtaposition
P
Q
coordination
(les membres sont
reliés par un connecteur)
P
*
Q
Subordination
(au moins un membre
de phrase dépendant)
P
p
*
*
q
Q
En syntaxe, le champ des phrases complexes est appelé supraphrastique. Le supraphrastique est au dessus des phrases.
1. Phrase complexe comprenant deux propositions indépendantes :
Deux propositions peuvent êtres indépendantes et reliées par la juxtaposition ou la coordination.
a) juxtaposition
procédé de mise l'une à coté de l'autre. Implication sémantico-logique.
hypotaxe.
Il est parti, il avait un rendez-vous. (égalité et inégalité)
parataxe
Il est parti, donne-moi une cigarette. (rupture)
Ces phénomènes ne sont pas syntaxiques mais sémantico-logiques.
b) coordination :
j'ai faim donc je mange
J'ai faim et je mange
La liste des morphèmes pouvant servir de connecteurs à une coordination est fermée :
mais ou et donc or ni car
Dans la plupart des grammaires puis, ainsi et alors ne font pas partie de la liste
Par ailleurs "ni" est curieux dans cette liste, alors que "soit" qui est également un marqueur dédoublé autour d'un syntagme nominal n'est pas dans la liste
ni…ni,
soit…soit.
2. La subordination
L'un des membres n'est pas indépendant syntaxiquement et est gouverné par une tête phrastique.
À l'aide de conjonctions comme qui ou que (ou dérivées de que : ainsi que, parce que, bien que, lorsque...), on introduit un constituant enchâssé à l'intérieur d'une phrase, subordonné à une tête.
a) La relative (expansion d'un syntagme nominal)
les pronoms relatifs "qui", "que", "quoi", "dont", "où" sont connecteurs et subordonnants.
Ce qui compte ce n'est pas la fonction du relatif mais l'antécédent.
L'homme qui avait un chapeau melon.
"l'homme" peut faire phrase (P est une proposition indépendante)
"avait un chapeau melon" (q est subordonné à une tête). Il s'agit d'une contrainte syntaxique.
La relative peut avoir des fonctions grammaticales diverses :
attribut :
folle que tu es
Bien malin qui trouvera la solution
objet :
Choisissez qui vous voudrez.
La bicyclette que tu désirais.
complément du nom :
l'aventure dont je parle
la chanteuse dont la voix me plait
complément indirect d'objet ou d'attribution :
l'homme à qui je rends visite
complément circonstanciel de lieu :
l'homme chez qui nous sommes
complément. circonstanciel de temps :
du temps où j'étais jeune
Par ailleurs, les relatives peuvent avoir plusieurs sens marqués par des pauses à l'oral et des virgules à l'écrit.
Relative déterminative (= restrictive)
Ma tante qui vit à Toronto est venue me voir.
(Celle de mes tantes qui vit à Toronto -> information connue)
Relative explicative (= appositive)
Ma tante, qui vit à Toronto, est venue me voir.
(Je n'ai qu'une tante et je vous informe qu'elle vit à Toronto -> information nouvelle)
b) La complétive (expansion du syntagme verbal)
Hors situation, construction d'un texte détaché avec structures complètes à discours détaché : Explication, description. (expansion du syntagme verbal introduit par un dérivé de que, et ayant des conséquences sur toute la phrase)
Dans :
Je pense qu'il viendra
"il viendra" est subordonné syntaxiquement et sémantiquement à "je pense"
Dans le cas d'une complétive comme :
je considère que tu devrais y aller.
du point de vue sémantique, c'est p qui est subordonné à Q étant donné que "tu devrais y aller" peut faire phrase, mais pas "je considère". Cependant, en syntaxe, on postule que tout ce qui suit "que" est subordonné à la proposition principale qui sert de protase.
C) la circonstancielle (expansion de la phrase)
Une proposition circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination (ou une locution conjonctive) (comme, puisque, si, quoique, quand, lorsque, parce que, au cas où, avant que, après que…). Elle peut marquer :
la condition
Si tu venais plus souvent, tes amis seraient heureux.
la manière
Nous nous parlons comme si nous nous connaissions depuis toujours.
le lieu
Où qu'ils soient, je les trouverai.
la cause
Je ne prendrai pas de dessert parce que je n'ai plus faim.
le temps
Je t'appellerai dès que j'arriverai.
la concession
Quoiqu'il soit sympathique, je n'ai pas confiance en lui
la conséquence
Il pleut, si bien que je ne vais pas sortir.
le but
Je vais t'aider afin que tu puisses finir à temps.
On aurait cependant tort de croire que la phrase complexe correspond toujours à une amplification du syntagme de base et que ses constituants sont toujours remplaçables par un syntagme nominal, adjectival ou prépositionnel. En effet dans la proposition la notion est affublée de caractéristiques locatives, temporelles et aspectuelles non présentes dans le syntagme simple.
C'est un homme qui a du talent mais qui s'en sert mal.
C'est un homme talentueux.
* C'est un homme talentueux mais qui s'en sert mal.
Nous souhaitons qu'il pleuve longtemps.
Nous souhaitons la pluie.
* Nous souhaitons la pluie longtemps.
J'irai te voir dès que la nuit sera tombée sur la ville.
J'irai te voir à la nuit tombée.
* J'irai te voir à la nuit tombée sur la ville.
Soulignons que, du point de vue énonciatif, les phrases complexes relèvent d'une construction en discours détaché renvoyant généralement à une explication ou à une description hors situation énonciative.
II Le discours rapporté
Le discours rapporté consiste, pour l'énonciateur, à citer les propos ou les pensées d'un autre énonciateur hors situation.
Seuls deux degrés d'enchâssement sont possibles :
Pierre m'a dit que Marie lui a raconté ce qui s'était passé.
Selon son degré de prise en charge des propos ou des idées de l'autre, l'énonciateur utilisera divers moyens syntaxiques :
1. Citation directe :
Le style direct permet de rendre compte et de rapporter des propos sans s'impliquer du point de vue de la prise en charge. Pour ce faire il utilise la juxtaposition.
Il a dit : « Il n'est pas beau, ton dessin !».
2. La citation indirecte
Par la citation indirecte, l'énonciateur s'implique plus sur sa prise en charge des propos rapportés. Le moyen syntaxique utilisé est la subordination :
Il prétend qu'il viendra.
(mais, le connaissant, je ne pense pas qu'il viendra -> prise en compte)
Pierre m'a annoncé qu'on va partir.
(prise en charge)
Prendre en charge, c'est dire ce qu'on considère ou donne comme vrai. Notons que le mensonge est toujours possible, même si les faits sont donnés comme vrais. La prise en charge peut être simulée.
Le rapport entre style direct et style indirect est, en fait, la possibilité de jouer sur la prise en charge.
3. Le discours intérieur libre
Il s'agit d'un effet de style introduit dans les romans au XIXe siècle.
On introduit dans le texte un élément mimant l'échange dialogique. Il y a une combinaison entre le style indirect et l'évocation d'un dialogue ou d'un monologue intérieur. Il n'y a pas de prise en charge de la part de l'auteur-énonciateur.
Le moyen syntaxique utilisé est alors la phrase simple ou la juxtaposition de phrases simples :
C'était décidé, il en avait assez, il ne la reverrait plus !
Notons qu'il est rare de rapporter les paroles d'un locuteur telles qu'elles ont été émises. La plupart du temps, on rapporte l'acte de langage que ces paroles sous-tendent.
Il s'est insurgé.
Il a revendiqué ses droits.
Il a déclaré sa foi.
Il a dénoncé ce scandale.
Il s'est plaint.
Il s'est excusé.
Il a nié...
I Typologie des phrases complexes
Le premier membre de la phrase sera appelé protase et le second membre apodose.
Protase Apodose
juxtaposition
P
Q
coordination
(les membres sont
reliés par un connecteur)
P
*
Q
Subordination
(au moins un membre
de phrase dépendant)
P
p
*
*
q
Q
En syntaxe, le champ des phrases complexes est appelé supraphrastique. Le supraphrastique est au dessus des phrases.
1. Phrase complexe comprenant deux propositions indépendantes :
Deux propositions peuvent êtres indépendantes et reliées par la juxtaposition ou la coordination.
a) juxtaposition
procédé de mise l'une à coté de l'autre. Implication sémantico-logique.
hypotaxe.
Il est parti, il avait un rendez-vous. (égalité et inégalité)
parataxe
Il est parti, donne-moi une cigarette. (rupture)
Ces phénomènes ne sont pas syntaxiques mais sémantico-logiques.
b) coordination :
j'ai faim donc je mange
J'ai faim et je mange
La liste des morphèmes pouvant servir de connecteurs à une coordination est fermée :
mais ou et donc or ni car
Dans la plupart des grammaires puis, ainsi et alors ne font pas partie de la liste
Par ailleurs "ni" est curieux dans cette liste, alors que "soit" qui est également un marqueur dédoublé autour d'un syntagme nominal n'est pas dans la liste
ni…ni,
soit…soit.
2. La subordination
L'un des membres n'est pas indépendant syntaxiquement et est gouverné par une tête phrastique.
À l'aide de conjonctions comme qui ou que (ou dérivées de que : ainsi que, parce que, bien que, lorsque...), on introduit un constituant enchâssé à l'intérieur d'une phrase, subordonné à une tête.
a) La relative (expansion d'un syntagme nominal)
les pronoms relatifs "qui", "que", "quoi", "dont", "où" sont connecteurs et subordonnants.
Ce qui compte ce n'est pas la fonction du relatif mais l'antécédent.
L'homme qui avait un chapeau melon.
"l'homme" peut faire phrase (P est une proposition indépendante)
"avait un chapeau melon" (q est subordonné à une tête). Il s'agit d'une contrainte syntaxique.
La relative peut avoir des fonctions grammaticales diverses :
attribut :
folle que tu es
Bien malin qui trouvera la solution
objet :
Choisissez qui vous voudrez.
La bicyclette que tu désirais.
complément du nom :
l'aventure dont je parle
la chanteuse dont la voix me plait
complément indirect d'objet ou d'attribution :
l'homme à qui je rends visite
complément circonstanciel de lieu :
l'homme chez qui nous sommes
complément. circonstanciel de temps :
du temps où j'étais jeune
Par ailleurs, les relatives peuvent avoir plusieurs sens marqués par des pauses à l'oral et des virgules à l'écrit.
Relative déterminative (= restrictive)
Ma tante qui vit à Toronto est venue me voir.
(Celle de mes tantes qui vit à Toronto -> information connue)
Relative explicative (= appositive)
Ma tante, qui vit à Toronto, est venue me voir.
(Je n'ai qu'une tante et je vous informe qu'elle vit à Toronto -> information nouvelle)
b) La complétive (expansion du syntagme verbal)
Hors situation, construction d'un texte détaché avec structures complètes à discours détaché : Explication, description. (expansion du syntagme verbal introduit par un dérivé de que, et ayant des conséquences sur toute la phrase)
Dans :
Je pense qu'il viendra
"il viendra" est subordonné syntaxiquement et sémantiquement à "je pense"
Dans le cas d'une complétive comme :
je considère que tu devrais y aller.
du point de vue sémantique, c'est p qui est subordonné à Q étant donné que "tu devrais y aller" peut faire phrase, mais pas "je considère". Cependant, en syntaxe, on postule que tout ce qui suit "que" est subordonné à la proposition principale qui sert de protase.
C) la circonstancielle (expansion de la phrase)
Une proposition circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination (ou une locution conjonctive) (comme, puisque, si, quoique, quand, lorsque, parce que, au cas où, avant que, après que…). Elle peut marquer :
la condition
Si tu venais plus souvent, tes amis seraient heureux.
la manière
Nous nous parlons comme si nous nous connaissions depuis toujours.
le lieu
Où qu'ils soient, je les trouverai.
la cause
Je ne prendrai pas de dessert parce que je n'ai plus faim.
le temps
Je t'appellerai dès que j'arriverai.
la concession
Quoiqu'il soit sympathique, je n'ai pas confiance en lui
la conséquence
Il pleut, si bien que je ne vais pas sortir.
le but
Je vais t'aider afin que tu puisses finir à temps.
On aurait cependant tort de croire que la phrase complexe correspond toujours à une amplification du syntagme de base et que ses constituants sont toujours remplaçables par un syntagme nominal, adjectival ou prépositionnel. En effet dans la proposition la notion est affublée de caractéristiques locatives, temporelles et aspectuelles non présentes dans le syntagme simple.
C'est un homme qui a du talent mais qui s'en sert mal.
C'est un homme talentueux.
* C'est un homme talentueux mais qui s'en sert mal.
Nous souhaitons qu'il pleuve longtemps.
Nous souhaitons la pluie.
* Nous souhaitons la pluie longtemps.
J'irai te voir dès que la nuit sera tombée sur la ville.
J'irai te voir à la nuit tombée.
* J'irai te voir à la nuit tombée sur la ville.
Soulignons que, du point de vue énonciatif, les phrases complexes relèvent d'une construction en discours détaché renvoyant généralement à une explication ou à une description hors situation énonciative.
II Le discours rapporté
Le discours rapporté consiste, pour l'énonciateur, à citer les propos ou les pensées d'un autre énonciateur hors situation.
Seuls deux degrés d'enchâssement sont possibles :
Pierre m'a dit que Marie lui a raconté ce qui s'était passé.
Selon son degré de prise en charge des propos ou des idées de l'autre, l'énonciateur utilisera divers moyens syntaxiques :
1. Citation directe :
Le style direct permet de rendre compte et de rapporter des propos sans s'impliquer du point de vue de la prise en charge. Pour ce faire il utilise la juxtaposition.
Il a dit : « Il n'est pas beau, ton dessin !».
2. La citation indirecte
Par la citation indirecte, l'énonciateur s'implique plus sur sa prise en charge des propos rapportés. Le moyen syntaxique utilisé est la subordination :
Il prétend qu'il viendra.
(mais, le connaissant, je ne pense pas qu'il viendra -> prise en compte)
Pierre m'a annoncé qu'on va partir.
(prise en charge)
Prendre en charge, c'est dire ce qu'on considère ou donne comme vrai. Notons que le mensonge est toujours possible, même si les faits sont donnés comme vrais. La prise en charge peut être simulée.
Le rapport entre style direct et style indirect est, en fait, la possibilité de jouer sur la prise en charge.
3. Le discours intérieur libre
Il s'agit d'un effet de style introduit dans les romans au XIXe siècle.
On introduit dans le texte un élément mimant l'échange dialogique. Il y a une combinaison entre le style indirect et l'évocation d'un dialogue ou d'un monologue intérieur. Il n'y a pas de prise en charge de la part de l'auteur-énonciateur.
Le moyen syntaxique utilisé est alors la phrase simple ou la juxtaposition de phrases simples :
C'était décidé, il en avait assez, il ne la reverrait plus !
Notons qu'il est rare de rapporter les paroles d'un locuteur telles qu'elles ont été émises. La plupart du temps, on rapporte l'acte de langage que ces paroles sous-tendent.
Il s'est insurgé.
Il a revendiqué ses droits.
Il a déclaré sa foi.
Il a dénoncé ce scandale.
Il s'est plaint.
Il s'est excusé.
Il a nié...
0/5000
On appelle phrase complexe toute phrase qui est composée de plusieurs propositions en ce sens qu'elle possède plus d'un verbe conjugué.I Typologie des phrases complexesLe premier membre de la phrase sera appelé protase et le second membre apodose.Protase Apodosejuxtaposition P Qcoordination(les membres sontreliés par un connecteur) P*QSubordination(au moins un membre de phrase dépendant) P p* *qQEn syntaxe, le champ des phrases complexes est appelé supraphrastique. Le supraphrastique est au dessus des phrases.1. Phrase complexe comprenant deux propositions indépendantes :Deux propositions peuvent êtres indépendantes et reliées par la juxtaposition ou la coordination.a) juxtapositionprocédé de mise l'une à coté de l'autre. Implication sémantico-logique.hypotaxe.Il est parti, il avait un rendez-vous. (égalité et inégalité)parataxeIl est parti, donne-moi une cigarette. (rupture)Ces phénomènes ne sont pas syntaxiques mais sémantico-logiques.b) coordination :j'ai faim donc je mangeJ'ai faim et je mangeLa liste des morphèmes pouvant servir de connecteurs à une coordination est fermée :mais ou et donc or ni carDans la plupart des grammaires puis, ainsi et alors ne font pas partie de la listePar ailleurs "ni" est curieux dans cette liste, alors que "soit" qui est également un marqueur dédoublé autour d'un syntagme nominal n'est pas dans la listeni…ni, soit…soit.
2. La subordination
L'un des membres n'est pas indépendant syntaxiquement et est gouverné par une tête phrastique.
À l'aide de conjonctions comme qui ou que (ou dérivées de que : ainsi que, parce que, bien que, lorsque...), on introduit un constituant enchâssé à l'intérieur d'une phrase, subordonné à une tête.
a) La relative (expansion d'un syntagme nominal)
les pronoms relatifs "qui", "que", "quoi", "dont", "où" sont connecteurs et subordonnants.
Ce qui compte ce n'est pas la fonction du relatif mais l'antécédent.
L'homme qui avait un chapeau melon.
"l'homme" peut faire phrase (P est une proposition indépendante)
"avait un chapeau melon" (q est subordonné à une tête). Il s'agit d'une contrainte syntaxique.
La relative peut avoir des fonctions grammaticales diverses :
attribut :
folle que tu es
Bien malin qui trouvera la solution
objet :
Choisissez qui vous voudrez.
La bicyclette que tu désirais.
complément du nom :
l'aventure dont je parle
la chanteuse dont la voix me plait
complément indirect d'objet ou d'attribution :
l'homme à qui je rends visite
complément circonstanciel de lieu :
l'homme chez qui nous sommes
complément. circonstanciel de temps :
du temps où j'étais jeune
Par ailleurs, les relatives peuvent avoir plusieurs sens marqués par des pauses à l'oral et des virgules à l'écrit.
Relative déterminative (= restrictive)
Ma tante qui vit à Toronto est venue me voir.
(Celle de mes tantes qui vit à Toronto -> information connue)
Relative explicative (= appositive)
Ma tante, qui vit à Toronto, est venue me voir.
(Je n'ai qu'une tante et je vous informe qu'elle vit à Toronto -> information nouvelle)
b) La complétive (expansion du syntagme verbal)
Hors situation, construction d'un texte détaché avec structures complètes à discours détaché : Explication, description. (expansion du syntagme verbal introduit par un dérivé de que, et ayant des conséquences sur toute la phrase)
Dans :
Je pense qu'il viendra
"il viendra" est subordonné syntaxiquement et sémantiquement à "je pense"
Dans le cas d'une complétive comme :
je considère que tu devrais y aller.
du point de vue sémantique, c'est p qui est subordonné à Q étant donné que "tu devrais y aller" peut faire phrase, mais pas "je considère". Cependant, en syntaxe, on postule que tout ce qui suit "que" est subordonné à la proposition principale qui sert de protase.
C) la circonstancielle (expansion de la phrase)
Une proposition circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination (ou une locution conjonctive) (comme, puisque, si, quoique, quand, lorsque, parce que, au cas où, avant que, après que…). Elle peut marquer :
la condition
Si tu venais plus souvent, tes amis seraient heureux.
la manière
Nous nous parlons comme si nous nous connaissions depuis toujours.
le lieu
Où qu'ils soient, je les trouverai.
la cause
Je ne prendrai pas de dessert parce que je n'ai plus faim.
le temps
Je t'appellerai dès que j'arriverai.
la concession
Quoiqu'il soit sympathique, je n'ai pas confiance en lui
la conséquence
Il pleut, si bien que je ne vais pas sortir.
le but
Je vais t'aider afin que tu puisses finir à temps.
On aurait cependant tort de croire que la phrase complexe correspond toujours à une amplification du syntagme de base et que ses constituants sont toujours remplaçables par un syntagme nominal, adjectival ou prépositionnel. En effet dans la proposition la notion est affublée de caractéristiques locatives, temporelles et aspectuelles non présentes dans le syntagme simple.
C'est un homme qui a du talent mais qui s'en sert mal.
C'est un homme talentueux.
* C'est un homme talentueux mais qui s'en sert mal.
Nous souhaitons qu'il pleuve longtemps.
Nous souhaitons la pluie.
* Nous souhaitons la pluie longtemps.
J'irai te voir dès que la nuit sera tombée sur la ville.
J'irai te voir à la nuit tombée.
* J'irai te voir à la nuit tombée sur la ville.
Soulignons que, du point de vue énonciatif, les phrases complexes relèvent d'une construction en discours détaché renvoyant généralement à une explication ou à une description hors situation énonciative.
II Le discours rapporté
Le discours rapporté consiste, pour l'énonciateur, à citer les propos ou les pensées d'un autre énonciateur hors situation.
Seuls deux degrés d'enchâssement sont possibles :
Pierre m'a dit que Marie lui a raconté ce qui s'était passé.
Selon son degré de prise en charge des propos ou des idées de l'autre, l'énonciateur utilisera divers moyens syntaxiques :
1. Citation directe :
Le style direct permet de rendre compte et de rapporter des propos sans s'impliquer du point de vue de la prise en charge. Pour ce faire il utilise la juxtaposition.
Il a dit : « Il n'est pas beau, ton dessin !».
2. La citation indirecte
Par la citation indirecte, l'énonciateur s'implique plus sur sa prise en charge des propos rapportés. Le moyen syntaxique utilisé est la subordination :
Il prétend qu'il viendra.
(mais, le connaissant, je ne pense pas qu'il viendra -> prise en compte)
Pierre m'a annoncé qu'on va partir.
(prise en charge)
Prendre en charge, c'est dire ce qu'on considère ou donne comme vrai. Notons que le mensonge est toujours possible, même si les faits sont donnés comme vrais. La prise en charge peut être simulée.
Le rapport entre style direct et style indirect est, en fait, la possibilité de jouer sur la prise en charge.
3. Le discours intérieur libre
Il s'agit d'un effet de style introduit dans les romans au XIXe siècle.
On introduit dans le texte un élément mimant l'échange dialogique. Il y a une combinaison entre le style indirect et l'évocation d'un dialogue ou d'un monologue intérieur. Il n'y a pas de prise en charge de la part de l'auteur-énonciateur.
Le moyen syntaxique utilisé est alors la phrase simple ou la juxtaposition de phrases simples :
C'était décidé, il en avait assez, il ne la reverrait plus !
Notons qu'il est rare de rapporter les paroles d'un locuteur telles qu'elles ont été émises. La plupart du temps, on rapporte l'acte de langage que ces paroles sous-tendent.
Il s'est insurgé.
Il a revendiqué ses droits.
Il a déclaré sa foi.
Il a dénoncé ce scandale.
Il s'est plaint.
Il s'est excusé.
Il a nié...
2. La subordination
L'un des membres n'est pas indépendant syntaxiquement et est gouverné par une tête phrastique.
À l'aide de conjonctions comme qui ou que (ou dérivées de que : ainsi que, parce que, bien que, lorsque...), on introduit un constituant enchâssé à l'intérieur d'une phrase, subordonné à une tête.
a) La relative (expansion d'un syntagme nominal)
les pronoms relatifs "qui", "que", "quoi", "dont", "où" sont connecteurs et subordonnants.
Ce qui compte ce n'est pas la fonction du relatif mais l'antécédent.
L'homme qui avait un chapeau melon.
"l'homme" peut faire phrase (P est une proposition indépendante)
"avait un chapeau melon" (q est subordonné à une tête). Il s'agit d'une contrainte syntaxique.
La relative peut avoir des fonctions grammaticales diverses :
attribut :
folle que tu es
Bien malin qui trouvera la solution
objet :
Choisissez qui vous voudrez.
La bicyclette que tu désirais.
complément du nom :
l'aventure dont je parle
la chanteuse dont la voix me plait
complément indirect d'objet ou d'attribution :
l'homme à qui je rends visite
complément circonstanciel de lieu :
l'homme chez qui nous sommes
complément. circonstanciel de temps :
du temps où j'étais jeune
Par ailleurs, les relatives peuvent avoir plusieurs sens marqués par des pauses à l'oral et des virgules à l'écrit.
Relative déterminative (= restrictive)
Ma tante qui vit à Toronto est venue me voir.
(Celle de mes tantes qui vit à Toronto -> information connue)
Relative explicative (= appositive)
Ma tante, qui vit à Toronto, est venue me voir.
(Je n'ai qu'une tante et je vous informe qu'elle vit à Toronto -> information nouvelle)
b) La complétive (expansion du syntagme verbal)
Hors situation, construction d'un texte détaché avec structures complètes à discours détaché : Explication, description. (expansion du syntagme verbal introduit par un dérivé de que, et ayant des conséquences sur toute la phrase)
Dans :
Je pense qu'il viendra
"il viendra" est subordonné syntaxiquement et sémantiquement à "je pense"
Dans le cas d'une complétive comme :
je considère que tu devrais y aller.
du point de vue sémantique, c'est p qui est subordonné à Q étant donné que "tu devrais y aller" peut faire phrase, mais pas "je considère". Cependant, en syntaxe, on postule que tout ce qui suit "que" est subordonné à la proposition principale qui sert de protase.
C) la circonstancielle (expansion de la phrase)
Une proposition circonstancielle est introduite par une conjonction de subordination (ou une locution conjonctive) (comme, puisque, si, quoique, quand, lorsque, parce que, au cas où, avant que, après que…). Elle peut marquer :
la condition
Si tu venais plus souvent, tes amis seraient heureux.
la manière
Nous nous parlons comme si nous nous connaissions depuis toujours.
le lieu
Où qu'ils soient, je les trouverai.
la cause
Je ne prendrai pas de dessert parce que je n'ai plus faim.
le temps
Je t'appellerai dès que j'arriverai.
la concession
Quoiqu'il soit sympathique, je n'ai pas confiance en lui
la conséquence
Il pleut, si bien que je ne vais pas sortir.
le but
Je vais t'aider afin que tu puisses finir à temps.
On aurait cependant tort de croire que la phrase complexe correspond toujours à une amplification du syntagme de base et que ses constituants sont toujours remplaçables par un syntagme nominal, adjectival ou prépositionnel. En effet dans la proposition la notion est affublée de caractéristiques locatives, temporelles et aspectuelles non présentes dans le syntagme simple.
C'est un homme qui a du talent mais qui s'en sert mal.
C'est un homme talentueux.
* C'est un homme talentueux mais qui s'en sert mal.
Nous souhaitons qu'il pleuve longtemps.
Nous souhaitons la pluie.
* Nous souhaitons la pluie longtemps.
J'irai te voir dès que la nuit sera tombée sur la ville.
J'irai te voir à la nuit tombée.
* J'irai te voir à la nuit tombée sur la ville.
Soulignons que, du point de vue énonciatif, les phrases complexes relèvent d'une construction en discours détaché renvoyant généralement à une explication ou à une description hors situation énonciative.
II Le discours rapporté
Le discours rapporté consiste, pour l'énonciateur, à citer les propos ou les pensées d'un autre énonciateur hors situation.
Seuls deux degrés d'enchâssement sont possibles :
Pierre m'a dit que Marie lui a raconté ce qui s'était passé.
Selon son degré de prise en charge des propos ou des idées de l'autre, l'énonciateur utilisera divers moyens syntaxiques :
1. Citation directe :
Le style direct permet de rendre compte et de rapporter des propos sans s'impliquer du point de vue de la prise en charge. Pour ce faire il utilise la juxtaposition.
Il a dit : « Il n'est pas beau, ton dessin !».
2. La citation indirecte
Par la citation indirecte, l'énonciateur s'implique plus sur sa prise en charge des propos rapportés. Le moyen syntaxique utilisé est la subordination :
Il prétend qu'il viendra.
(mais, le connaissant, je ne pense pas qu'il viendra -> prise en compte)
Pierre m'a annoncé qu'on va partir.
(prise en charge)
Prendre en charge, c'est dire ce qu'on considère ou donne comme vrai. Notons que le mensonge est toujours possible, même si les faits sont donnés comme vrais. La prise en charge peut être simulée.
Le rapport entre style direct et style indirect est, en fait, la possibilité de jouer sur la prise en charge.
3. Le discours intérieur libre
Il s'agit d'un effet de style introduit dans les romans au XIXe siècle.
On introduit dans le texte un élément mimant l'échange dialogique. Il y a une combinaison entre le style indirect et l'évocation d'un dialogue ou d'un monologue intérieur. Il n'y a pas de prise en charge de la part de l'auteur-énonciateur.
Le moyen syntaxique utilisé est alors la phrase simple ou la juxtaposition de phrases simples :
C'était décidé, il en avait assez, il ne la reverrait plus !
Notons qu'il est rare de rapporter les paroles d'un locuteur telles qu'elles ont été émises. La plupart du temps, on rapporte l'acte de langage que ces paroles sous-tendent.
Il s'est insurgé.
Il a revendiqué ses droits.
Il a déclaré sa foi.
Il a dénoncé ce scandale.
Il s'est plaint.
Il s'est excusé.
Il a nié...
đang được dịch, vui lòng đợi..


Gọi là câu phức tạp bất kỳ câu đó bao gồm một số đề xuất trong đó nó có nhiều hơn một động từ liên hợp. Tôi Phân loại các câu phức tạp Phần đầu của câu sẽ được gọi là màn đầu của vở kịch apodosis và thành viên thứ hai. Protase apodosis kề nhau P Q phối hợp (các thành viên được kết nối bởi một connector) P * Q lệ thuộc (ít nhất một thành viên cụm từ phụ thuộc) P p * * q Q Trong cú pháp, các câu phức tạp được gọi là trường supraphrastique. Supraphrastique là các cụm từ trên. 1. Các câu phức tạp bao gồm hai độc lập khoản :. Hai đề xuất có thể con độc lập và kết nối bởi các gạch nối hoặc phối hợp a) đặt cạnh nhau thiết lập để xử lý bên cạnh khác. Hàm ý Semantic và hợp lý. Hypotaxis. Ông đã đi xa, ông đã có một cuộc hẹn. (bình đẳng và bất bình đẳng) la liệt cú pháp Ông đã đi xa, cung cấp cho tôi một điếu thuốc. (vỡ) Những hiện tượng này không phải là cú pháp, nhưng ngữ nghĩa và hợp lý. b) Phối hợp: tôi đói quá tôi ăn, tôi đói và tôi ăn danh sách hình vị có thể phục vụ như là một kết nối phối hợp được đóng lại: nhưng ở đâu và do đó vàng cũng không phải vì trong hầu hết các văn phạm tiếng sau đó và sau đó và không phải là một phần của danh sách cũng "không" là tò mò trong danh sách này, trong khi "hay" đó cũng là một dấu hiệu chia rẽ xung quanh một cụm danh từ n ' không có trong danh sách cả hai không biết, hoặc là ... hoặc. 2. Lệ thuộc Một thành viên không phải là độc lập cú pháp và được quản lý bởi một đầu mệnh đề. Sử dụng mà là liên từ hay (hoặc có nguồn gốc từ đó: và bởi vì, khi ... ), giới thiệu một thành phần nhúng trong một câu, phụ thuộc vào một cái đầu. a) tương đối (mở rộng của một cụm danh từ) các đại từ tương đối "đó", "cái đó", "cái gì", "mà "," ở đâu "là kết nối và subordinators. Điều quan trọng không phải là chức năng của tương đối nhưng các tiền đề. Người đàn ông đã có một bowler hat." người đàn ông "có thể tuyên án (P là một đề nghị độc lập ) "đã có một chiếc mũ quả dưa" (q là cấp dưới một cái đầu). Đây là một hạn chế cú pháp. Thân nhân có thể có chức năng ngữ pháp khác nhau: thuộc tính: điên rằng bạn là giải pháp rất thông minh mà sẽ tìm thấy các đối tượng:. Chọn người mà bạn muốn. Những chiếc xe đạp bạn muốn sở hữu cách: các cuộc phiêu lưu của tôi Tôi nói ca sĩ có giọng tôi thích gián tiếp bổ sung đối tượng hoặc phân bổ: người đàn ông mà tôi ghé thăm phó từ các nơi: người đàn ông mà chúng tôi bổ sung. thời gian gián: thời gian khi tôi đã. trẻ Hơn nữa, tương đối có thể có nhiều ý nghĩa đánh dấu bằng tạm dừng trong khi nói và viết dấu phẩy xét tương đối (= hạn chế) dì của tôi đang sống ở Toronto đến tôi. (The một trong các dì của tôi đang sống ở Toronto -> thông tin đã biết) giải tương đối (= appositive) dì của tôi, những người sống ở Toronto, đến với tôi. (Tôi có một người dì và tôi thông báo cho bạn rằng nó sống ở Toronto -> thông tin mới) b) Các bổ xung (mở rộng các cụm động từ) Out vị trí, xây dựng một văn bản tách ra với cấu trúc hoàn chỉnh để mất bài phát biểu: Giải thích, mô tả. (mở rộng các cụm động từ giới thiệu của một phái sinh từ, và có hậu quả cho cả câu) Trong: Tôi nghĩ rằng nó sẽ đến "sẽ đến" là cú pháp và ngữ nghĩa thuộc "Tôi nghĩ rằng" Trong trường hợp của một bổ xung như thế, tôi nghĩ rằng bạn nên đi. điểm ngữ nghĩa của xem, là đó là cấp dưới để p Q là "bạn nên đi" có thể kết án nhưng không "Tôi tin". Tuy nhiên, cú pháp, nó được giả định rằng tất cả mọi thứ sau khi "rằng" chỉ là nhánh của mệnh đề chính mà phục vụ màn đầu của vở kịch. C) gián tiếp (mở rộng của câu) đề nghị hoàn cảnh được giới thiệu bởi một liên từ phụ thuộc (hoặc cụm từ kết mạc) (như, vì, nếu, mặc dù, khi nào, ở đâu, bởi vì, trong trường hợp đó, trước, sau ...). Nó có thể đánh dấu: điều kiện Nếu bạn thường đến, bạn bè của bạn sẽ được hạnh phúc. Cách chúng ta nói như thể chúng ta đã được biết đến mãi mãi. Những nơi mà họ đang có, tôi sẽ tìm thấy chúng. Nguyên nhân tôi sẽ không mất món tráng miệng bởi vì tôi không đói nữa. thời gian tôi sẽ gọi cho bạn ngay sau khi tôi đến nơi. Concession Mặc dù nó là tốt đẹp, tôi không tin tưởng anh ta là hậu quả Trời mưa, vì vậy tôi không đi ra ngoài . Mục tiêu của tôi sẽ giúp bạn để bạn có thể hoàn thành đúng thời hạn. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm để tin rằng các câu phức tạp luôn luôn tương ứng với một sự khuếch đại của các cụm từ cơ bản và các thành phần của nó là luôn luôn có thể thay thế bằng một cụm danh từ, tính từ hoặc giới từ . Thật vậy trong đề xuất khái niệm này được trang hoàng trong các đặc tính thuê theo hợp đồng, thời gian và aspectual không có mặt trong các câu đơn giản. Điều này là một người đàn ông có tài năng nhưng ai sai. Đây là một người đàn ông có tài. * C ' là một người đàn ông tài năng, nhưng người sử dụng ác. Chúng tôi muốn nó mưa một thời gian dài. Chúng tôi muốn mưa. * Chúng tôi muốn dài mưa. Tôi sẽ gặp bạn ngay khi màn đêm buông xuống trên thành phố. Tôi sẽ đi nhìn thấy bạn vào ban đêm. * Tôi sẽ nhìn thấy bạn khi đêm xuống trên thành phố. Lưu ý rằng, điểm enunciative xem, câu phức tạp là một phần của một bài giảng xây dựng tách ra thường đề cập đến một lời giải thích hay mô tả . off vị trí enunciative II báo cáo phát biểu Các bài phát biểu được báo cáo là cho loa để trích dẫn hoặc những suy nghĩ của người khác utterer tắt tình hình. Chỉ có hai mức độ nhúng có thể là: Pierre nói với ông rằng Mary . liên quan gì đã xảy ra Tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ cho những lời hay ý tưởng khác, người nói sẽ sử dụng phương tiện cú pháp khác nhau: 1. Báo giá trực tiếp: Các phong cách trực tiếp cho phép chúng tôi để hạch toán và báo cáo về mà không liên quan đến điều khoản hỗ trợ. . Để làm được điều này nó sử dụng vị trí kề nhau Anh cho biết: "Đó không phải là đẹp, hình ảnh của bạn!". 2. Phần trích dẫn gián tiếp Ví quote gián tiếp, người nói là có liên quan về ý kiến ủng hộ báo cáo. Cú pháp sử dụng là sự lệ thuộc có nghĩa là:. Ông tuyên bố rằng ông sẽ đến (Tuy nhiên, khi biết anh, tôi không nghĩ rằng nó sẽ -> xem xét) Pierre nói với tôi rằng chúng tôi sẽ đi. (Hỗ trợ ) Chịu trách, tức là những gì được coi là đúng hay mang lại. Lưu ý vùng đó là luôn luôn có thể, ngay cả khi sự thật được cho là đúng. Sự hỗ trợ có thể được mô phỏng. Tỷ lệ giữa lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp được, trên thực tế, cơ hội để chơi trên hỗ trợ. 3. Các bài phát biểu nội miễn phí Đây là một tác phong giới thiệu trong các tiểu thuyết trong thế kỷ XIX. Nó giới thiệu một yếu tố trong văn bản bắt chước việc trao đổi đối thoại. Có một sự kết hợp của phong cách gián tiếp và gọi hồn của một cuộc đối thoại hay độc thoại. Không có sự hỗ trợ trên một phần của utterer tác giả. Cú pháp sau đó được sử dụng thông qua các cụm từ đơn giản hoặc gạch nối giữa các câu đơn giản: Nó đã được quyết định, ông đã có đủ, ông sẽ xem xét lại hơn! Lưu ý rằng nó là bất thường để mang lại những lời của một người nói là họ đã được ban hành. Hầu hết thời gian, nó đã được báo cáo các hành động ngôn rằng những từ đằng sau. Ông nổi dậy. Ông tuyên bố chủ quyền của mình. Ông cho biết đức tin của mình. Ông lên án các vụ bê bối. Ông phàn nàn. Anh xin lỗi. Anh ta bị từ chối ...
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- long time no selfie
- những cuốn sách mà chúng tôi đều t
- il a bien passe le bac
- party
- unstructures, an open discussion of your
- Ya. But I just want to get the info out
- một thời để nhớ
- Không sao đâuTôi quen rồi màCảm ơn bạn đ
- i drink several cups of tea , have a qui
- Không sao đâuTôi quen rồi màCảm ơn bạn đ
- they killed at the end of the flim
- 고궁
- Since it was founded over 100 years ago,
- tim tôi đau nhói.........khi có người xú
- God knows all...What is written in our l
- lịch sử hình thành và phát triển
- cơm cháy, thịt dê
- reagrrange these words into the correct
- say you do
- Luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung
- Mẹ tôi đun nấu và đi chợ
- I laugh because I feel you more beautifu
- THÁNG 6
- tôi rất tự hào về ngôi trường này