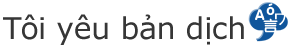- Văn bản
- Lịch sử
De leur côté, les juges du fond s’i
De leur côté, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arrêt censurant leur décision, sur l’interprétation d’un précédent jurisprudentiel ou sur la portée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reçues certaines cassations pour défaut de réponse aux conclusions : n’est-ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouvé, dans un litige de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou provoqués, conduisant à de très nombreuses conclusions interminables, enchevêtrées et touffues...?
Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.
Analyse des difficultés de compréhension des arrêts
Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :
a) de la logique juridique des arrêts ;
b) de la politique et de la pratique judiciaire.
a) la logique juridique des arrêts
Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.
Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.
Analyse des difficultés de compréhension des arrêts
Ces difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :
a) de la logique juridique des arrêts ;
b) de la politique et de la pratique judiciaire.
a) la logique juridique des arrêts
Si les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.
Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
0/5000
De leur côté, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arrêt censurant leur décision, sur l’interprétation d’un précédent jurisprudentiel ou sur la portée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple grâce aux motifs présumés adoptés des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reçues certaines cassations pour défaut de réponse aux conclusions : n’est-ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouvé, dans un litige de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou provoqués, conduisant à de très nombreuses conclusions interminables, enchevêtrées et touffues...?Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en matière civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’éprouvent aucun plaisir à casser un arrêt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relevées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appréciation.Analyse des difficultés de compréhension des arrêtsCes difficultés ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant :a) de la logique juridique des arrêts ;b) de la politique et de la pratique judiciaire.a) la logique juridique des arrêtsSi les arrêts de la Cour sont d’interprétation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arrêt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la décision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le réfute, elle casse la décision attaquée.Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa décision, en ce sens qu’elle “dit le droit” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interprétation de la loi. Cette absence de “motivation” des arrêts est fréquemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas restée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour européenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement accès, ainsi que tous les magistrats pour les arrêts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat général (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arrêt prononcé permet d’appréhender aisément la problématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la société telles que prises en compte par les décisions des juges du fond.
đang được dịch, vui lòng đợi..


Về phần mình, các thẩm phán xử án thường đặt câu hỏi về ý nghĩa của một điểm dừng kiểm duyệt các quyết định của mình về việc giải thích của một tiền lệ pháp lý hoặc phạm vi của một quyết định. Vì vậy, chúng ta có thể thu hút vào việc bác bỏ sự xuất hiện thỏa đáng cho các tòa án xét xử, mà thực chất là một quyết định cuộc sống, ví dụ do căn cứ cáo buộc cho các thẩm phán đầu tiên. Ngược lại, chúng ta biết rằng một số ít được nhận cassations để trả lời kết luận: không đau buồn thực sự khó khăn để chấp nhận các thẩm phán kháng cáo đã tìm thấy chính mình trong một tranh chấp bất động sản, trước khi một chục người trả lời, chứng khoán thế chấp, sự cố hoặc các cuộc gọi khiêu khích, dẫn đến nhiều kết luận bất tận, rối và rậm ...?
Tuy nhiên không phải tất cả những người đến dưới cùng của thẩm phán trong việc đào tạo tại Toà án cấp giám đốc thẩm cũng nhận thức được rằng trong khi các vụ án dân sự tỷ đồng giám đốc thẩm là khoảng 30% các khiếu nại, thẩm phán của Tòa án không có niềm vui trong việc phá vỡ một điểm dừng. Nhưng ngoại trừ việc từ bỏ nhiệm vụ riêng của mình, Tòa án chỉ có thể phá vỡ khi luật pháp là rõ ràng và các hoàn cảnh thực tế vô cùng xác định bởi các thẩm phán xử án để nó không có quyền quyết định.
khó khăn hiểu điểm dừng Phân tích
Những khó khăn này, về cơ bản, có hai loại nguyên nhân liên quan đến:
a) của logic pháp lý của bản án;
. b) việc thực hành chính trị và tư pháp
một) logic pháp dừng
Nếu bản án của Tòa án là của 'giải thích tinh tế thực sự là lần đầu tiên bởi vì nhiệm vụ của Tòa án, theo chú thích III của Tiêu đề XVI của cuốn sách đầu tiên của Bộ luật tố tụng dân sự, khiếu nại ở giám đốc thẩm là một biện pháp bất thường mà có xu hướng, theo Điều 604, "để khiển trách bởi Tòa án giám đốc thẩm của không tuân thủ mà các địa chỉ các quy tắc của pháp luật". Vì vậy, như bất kỳ quyết định tư pháp, một phán quyết của Tòa án Giám đốc thẩm là việc chính thức của lập luận của Tòa án đó, bắt đầu từ hoàn cảnh thực tế sovereignly lựa chọn bởi ban giám khảo của thực tế, nhận được một thách thức đối với các quyết định của Thẩm phán đáy bằng phương tiện của một lập luận pháp lý. Nếu nó chấp nhận lý luận của các thẩm phán, nó bác bỏ kháng cáo. Nếu nó từ chối nó, nó phá vỡ các quyết định gây tranh cãi.
Nhưng, trái với những gì nó đòi hỏi thẩm phán xét xử, Tòa án giám đốc thẩm, thẩm phán của pháp luật, không thể hiện được những lý do cho quyết định này, trong đó nó "tiểu bang của pháp luật" mà không nói lý do tại sao nó ủng hộ một giải thích cụ thể của pháp luật. Điều này thiếu "động lực" của bản án là thường xuyên bị chỉ trích bởi các giáo lý, và Tòa án Tối cao đã không còn miễn dịch với những lời chỉ trích này. Kể từ khi lên án của Pháp bởi Tòa án châu Âu ở Strasbourg, Tòa án giám đốc thẩm đã thay đổi sâu sắc các điều kiện kiểm tra kháng cáo, kể từ khi các bên và luật sư của họ có bây giờ dễ dàng truy cập và tất cả các thẩm phán cho bản án được công bố trên Báo cáo Mục tiêu của báo cáo và các ý kiến của Advocate General (2). Một so sánh đơn giản của các yếu tố này với bản án giao cho phép dễ dàng xử lý các vấn đề của sự hấp dẫn, các giải pháp có thể và các yếu tố được đưa vào tài khoản của Toà án cấp giám đốc thẩm trong việc lựa chọn các giải pháp. Nhưng nỗ lực minh bạch này dường như không lên để biến đổi các tính chất của nhiệm vụ của Tòa án, trong đó cho phép nó để thay đổi luật học dựa trên các đột biến của công ty như được phản ánh bởi các quyết định của Toà án cấp dưới .
Tuy nhiên không phải tất cả những người đến dưới cùng của thẩm phán trong việc đào tạo tại Toà án cấp giám đốc thẩm cũng nhận thức được rằng trong khi các vụ án dân sự tỷ đồng giám đốc thẩm là khoảng 30% các khiếu nại, thẩm phán của Tòa án không có niềm vui trong việc phá vỡ một điểm dừng. Nhưng ngoại trừ việc từ bỏ nhiệm vụ riêng của mình, Tòa án chỉ có thể phá vỡ khi luật pháp là rõ ràng và các hoàn cảnh thực tế vô cùng xác định bởi các thẩm phán xử án để nó không có quyền quyết định.
khó khăn hiểu điểm dừng Phân tích
Những khó khăn này, về cơ bản, có hai loại nguyên nhân liên quan đến:
a) của logic pháp lý của bản án;
. b) việc thực hành chính trị và tư pháp
một) logic pháp dừng
Nếu bản án của Tòa án là của 'giải thích tinh tế thực sự là lần đầu tiên bởi vì nhiệm vụ của Tòa án, theo chú thích III của Tiêu đề XVI của cuốn sách đầu tiên của Bộ luật tố tụng dân sự, khiếu nại ở giám đốc thẩm là một biện pháp bất thường mà có xu hướng, theo Điều 604, "để khiển trách bởi Tòa án giám đốc thẩm của không tuân thủ mà các địa chỉ các quy tắc của pháp luật". Vì vậy, như bất kỳ quyết định tư pháp, một phán quyết của Tòa án Giám đốc thẩm là việc chính thức của lập luận của Tòa án đó, bắt đầu từ hoàn cảnh thực tế sovereignly lựa chọn bởi ban giám khảo của thực tế, nhận được một thách thức đối với các quyết định của Thẩm phán đáy bằng phương tiện của một lập luận pháp lý. Nếu nó chấp nhận lý luận của các thẩm phán, nó bác bỏ kháng cáo. Nếu nó từ chối nó, nó phá vỡ các quyết định gây tranh cãi.
Nhưng, trái với những gì nó đòi hỏi thẩm phán xét xử, Tòa án giám đốc thẩm, thẩm phán của pháp luật, không thể hiện được những lý do cho quyết định này, trong đó nó "tiểu bang của pháp luật" mà không nói lý do tại sao nó ủng hộ một giải thích cụ thể của pháp luật. Điều này thiếu "động lực" của bản án là thường xuyên bị chỉ trích bởi các giáo lý, và Tòa án Tối cao đã không còn miễn dịch với những lời chỉ trích này. Kể từ khi lên án của Pháp bởi Tòa án châu Âu ở Strasbourg, Tòa án giám đốc thẩm đã thay đổi sâu sắc các điều kiện kiểm tra kháng cáo, kể từ khi các bên và luật sư của họ có bây giờ dễ dàng truy cập và tất cả các thẩm phán cho bản án được công bố trên Báo cáo Mục tiêu của báo cáo và các ý kiến của Advocate General (2). Một so sánh đơn giản của các yếu tố này với bản án giao cho phép dễ dàng xử lý các vấn đề của sự hấp dẫn, các giải pháp có thể và các yếu tố được đưa vào tài khoản của Toà án cấp giám đốc thẩm trong việc lựa chọn các giải pháp. Nhưng nỗ lực minh bạch này dường như không lên để biến đổi các tính chất của nhiệm vụ của Tòa án, trong đó cho phép nó để thay đổi luật học dựa trên các đột biến của công ty như được phản ánh bởi các quyết định của Toà án cấp dưới .
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- Take everysecond of everyday and bring e
- ước mơ bình dị của các trẻ em vùng sông
- Take every second of everyday and bring
- nhà tôi đẹp hơn nhà bạn
- je suis perdue.je cherche la plase du ch
- Nhiều lần Khanh cảm thấy rất đói nhưng k
- .je cherche la plase du châtelet
- I learn Korean because I like
- [6월 7일(일) #CLC 영풍문고 코엑스점 사인회 및 버스킹 안내] 사
- Most w.c
- Ông không chỉ là một người đàn ông tuyệt
- Murad At-A-GlanceStrengths: A few good c
- PROS:Silky texture is easy to apply and
- Murad At-A-GlanceStrengths: A few good c
- PROS:Silky texture is easy to apply and
- dù thế nào đi chăng nữa
- breathe
- SAo cũng được, miễn là tôi không pha
- dù thế nào đi chăng nữa
- Sự việc vẫn đang được các phóng viên tiế
- Tên của bố cậu bé là Quyền ,tên của mẹ c
- Một người hàng xóm của cậu bé đã kể lại
- Because I meet him
- nhìn thật kĩ